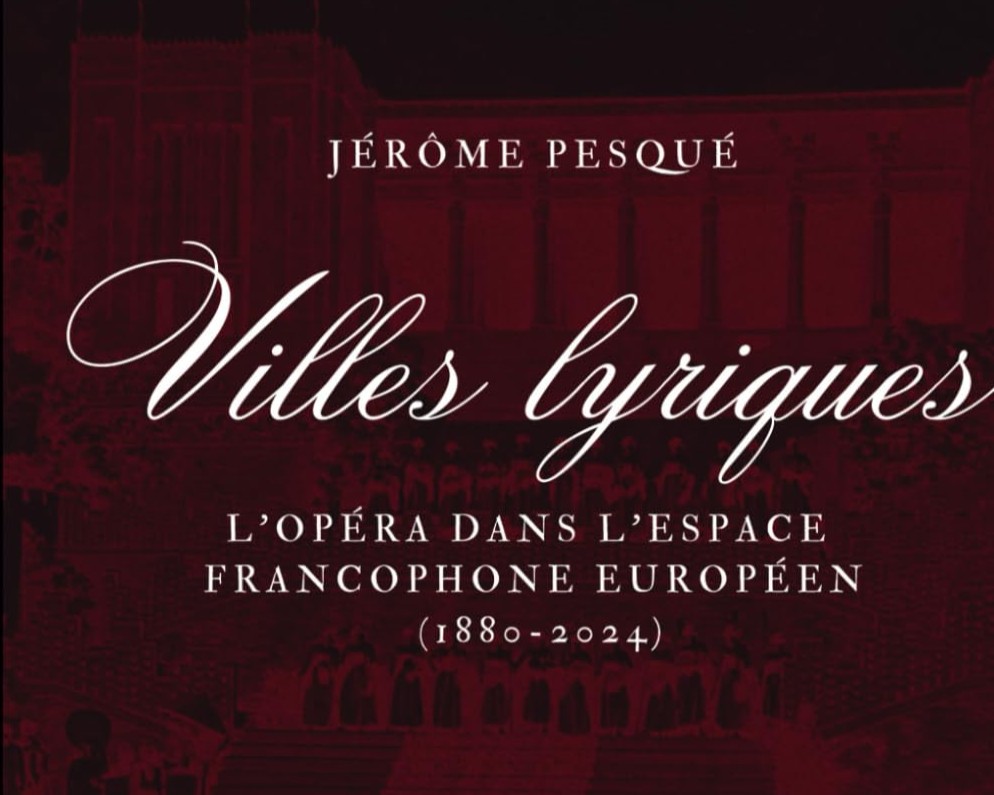Après son hommage à Régine Crespin (La vie et le chant d’une femme, 2021), Jérôme Pesqué fait paraître Villes lyriques – L’Opéra dans l’espace francophone européen (1880-2024). L’ouvrage est précédé d’un bref avant-propos particulièrement intéressant : en une dizaine de pages, l’auteur y explique tout d’abord comment se sont construits, et comment ont évolué les répertoires au fil des quelque 150 années que couvre cette étude. On est ainsi surpris de constater que certaines œuvres qui ne sont pour nous, dans le meilleur des cas, que des titres (Le Cheval de bronze d’Auber, Roland à Roncevaux de Mermet, Niniche de Boulard) comptaient parmi les ouvrages les plus joués au tournant du siècle. L’étude de Jérôme Pesqué corrobore également ce que l’on savait déjà, à savoir la quasi disparition, à de rares exceptions près (Offenbach, bien sûr), de tout un répertoire « léger » qui faisait les délices du public français jusque dans les années 70/80… Le phénomène est bien connu (et nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer dans un édito : « Il nous faut de l’humour, n’en fût-il plus au monde… »). Il n’empêche : lire la liste des opérettes, opéras-bouffes et opéras-comiques que donnaient les scènes parisiennes et les théâtres français jusque dans les années 80 (Les Dragons de Villars, Les Saltimbanques, Les Cloches de Corneville, Rip, Miss Heylett, Le Petit Duc, La Mascotte…) nous emplit d’une nostalgie certaine… L’auteur pourtant se défend de tout passéisme : tout était loin d’être parfait au XXe siècle, et Jérôme Pesqué, à l’heure où les metteurs en scène subissent fréquemment les foudres de la critique et du public, rappelle judicieusement qu’il fut une époque où l’on se contentait d’indiquer aux chanteurs s’ils devaient sortir côté cour ou côté jardin, et où les interprètes arrivaient sur les lieux d’une production avec leur propre garde-robe en guise de costumes !
Pourtant, force est de constater qu’en terme de nombre de levers de rideaux, l’opéra n’est plus aujourd’hui que l’ombre de ce qu’il était jadis… Même certaines scènes nationales (Bordeaux, Montpellier) ont connu (surtout dans les années qui ont suivi la crise sanitaire liée à la Covid) – ou connaissent encore – des saisons d’une maigreur désespérante. Si l’on ajoute à cela le vieillissement significatif du public, le tableau est loin d’être réjouissant… Jérôme Pesqué évoque malgré tout quelques évolutions salutaires dans le monde lyrique d’aujourd’hui, à savoir la féminisation, aujourd’hui bien ancrée, de certaines professions – même si des progrès restent à faire : cheffes d’orchestre et metteuses en scène sont certes fréquemment sollicitées aujourd’hui, mais le nombre de directrices de salles de concert ou d’opéras reste extrêmement bas…) ; et surtout, les actions à destination du jeune public qui sont aujourd’hui implantées dans de très nombreuses institutions et offrent souvent des actions ou des programmations de grande qualité.
Après ce préambule posant le cadre de façon claire et argumentée, Jérôme Pesqué fait un tour de France (et voyage même un peu au-delà puisque Monaco, la Belgique, la Suisse francophones sont aussi concernées par son étude) et s’arrête dans chaque ville ayant ou ayant eu un théâtre lyrique : il en résume alors l’histoire lyrico-musicale et offre une liste sinon exhaustive, du moins très complète des œuvres qui y ont été données saison après saison… Au fil des pages, on s’étonnera de l’audace de certaines salles (Tours présenta La Finta semplice de Mozart en 1982), ou de la frilosité de certaines autres (Nîmes, qui attendit 1987 pour découvrir Pelléas et Mélisande) ! On se rappellera avec nostalgie que les distributions affichées par certaines salles de province n’avaient rien à envier aux plus grandes scènes internationales (Mirella Freni, Nicolaï Ghiaurov, Montserrat Caballé, Régine Crespin, Lucia Valentini-Terrani à Avignon ; Elizabeth Schwarzkopf, Teresa Berganza à Nantes ; Cecilia Gasdia, Martine Dupuy, Gregory Kunde, Mario del Monaco, Leonie Rysanek, Gwyneth Jones, Placido Domingo, Alfredo Kraus, Raina Kabaivanska à Marseille !). Et en fonction de son âge et de son passé de mélomane, la lecture de certaines programmations suscitera des regrets (« Si j’avais vécu à cette époque… ») ou vous empliront de nostalgie. Allez… Une fois n’est pas coutume : livrons quelques souvenirs personnels, et avouons avoir lu avec beaucoup d’émotion les titres et distributions de certains spectacles auxquels, enfant ou adolescent, il nous a été donné d’assister : cette fameuse Finta semplice tourangelle, mais aussi la venue de Carlo Bergonzi dans ce même Grand Théâtre de Tours en 1982 ; la dernière Carmen de Crespin à Nîmes aux côtés d’Alain Vanzo (1981) ; la Turandot de Jones (1985), l’Adalgisa de Dupuy (1987), toujours à Nîmes ; la première production intégrale des Troyens à Lyon avec une Kathryn Harries bouleversante en Didon (1987) ; l’affiche incroyable, digne d’une distribution scaligère, de certain Don Carlo avignonnais : Luchetti, Freni, Zancanaro, Ghiaurov, Toczyska (1984)…
Laissez-vous guider par l’auteur à travers ces quelque 40 villes de l’espace lyrique francophone européen des années 1880-2024 : surprises, nostalgie, émotion garanties !
———————————————————–
Jérôme Pesqué, Villes lyriques -L’Opéra dans l’espace francophone européen (1880-20024), 2025.