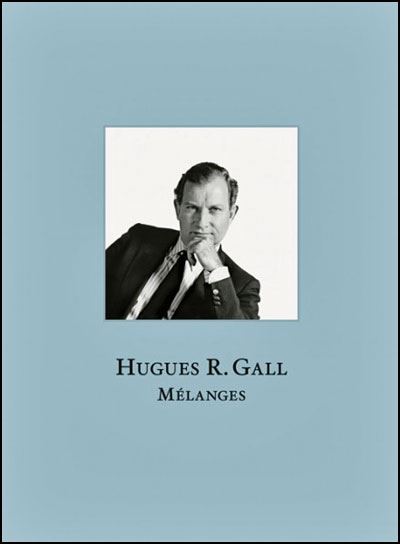La création de l’Opéra Bastille suscita une opposition d’une virulence qu’on a aujourd’hui quelque peu oubliée. Le projet fut critiqué pour son budget mais aussi pour des raisons idéologiques, les deux problématiques étant d’ailleurs liées : fallait-il dépenser autant d’argent pour un art considéré comme étant réservé à une élite ? De fait, lorsque François Léotard devient ministre de la culture en 1986, les travaux sont immédiatement suspendus. Ils reprendront cependant de façon à permettre l’inauguration du bâtiment le 14 juillet 1989. Pierre Bergé devient directeur de l’Opéra, avant d’être remplacé (Jacques Chirac étant devenu Président de la République) par Hugues Gall[i] (1940-2024).
Une décision qui ne laissa pas de surprendre, Hugues Gall ayant précédemment déclaré publiquement son opposition à l’Opéra Bastille, qu’il considérait comme « une mauvaise réponse à une question qui ne se posait pas ». Après avoir renvoyé le chef d’orchestre Myung-Whun Chung – qui avait donné à l’institution un indéniable rayonnement international – , Hugues Gall va apporter à l’Opéra de Paris la stabilité qui lui avait fait défaut depuis des années, au cours d’une gouvernance qui durera dix ans, de 1994 à 2004. Cette stabilité se traduira par une programmation de qualité (même si elle apparaît peut-être avec le recul un peu sage, avec assez peu de prises de risques et une très large place accordée aux œuvres les plus populaires) mais aussi un respect des impératifs économiques.
Si les ouvrages lyriques programmés à l’Opéra de Paris de 1994 à 2004 sont donc globalement plutôt attendus (sans surprise, La Flûte enchantée, Carmen, La bohème et Tosca furent les œuvres les plus représentées sous la gouvernance de Hugues Gall), il faut rappeler cependant la place accordée par le directeur à la création et au répertoire contemporain avec Salammbô (Philippe Fénelon), K (Philippe Manoury), Pérela, l’homme de fumée (Pascal Dusapin), L’Espace dernier (Matthias Pintscher). Hugues Gall marque par ailleurs son mandat par les invitations d’artistes de grande envergure : James Conlon devient directeur musical ; Robert Carsen sera invité extrêmement souvent, mais au nombre des metteurs en scène prestigieux, il faut également citer Andrei Serban, Lev Dodin, Willy Decker, Graham Vick, Laurent Pelly, Jorge Lavelli … Les grandes voix sont également bien présentes à Garnier comme à Bastille, avec entre autres Renée Fleming, Susan Graham, Natalie Dessay, Samuel Ramey, Neil Schicoff ou Placido Domingo. Enfin, bien avant le mouvement qui impose aujourd’hui très légitimement la présence des metteuses en scène sur la plupart des scènes nationales et internationales, Hugues Gall invita Francesca Zambello, Coline Serreau, ou encore Josée Dayan et Jeanne Moreau à mettre en scène diverses œuvres du répertoire.
C’est à cette personnalité particulièrement riche (et dont la carrière ne se limite pas à ses activités parisiennes : Gall fut également, entre autres, directeur du Grand Théâtre de Genève) qu’est consacré l’ouvrage tout récemment publié par Gourcuff Gradenigo : non pas une biographie mais des Mélanges, soit des hommages rendus à Hugues Gall par diverses personnalités qui l’ont côtoyé. Metteurs en scène (Robert Carsen, Allex Aguilera), hommes politiques (Thierry Breton, Xavier Darcos), chefs d’orchestre (William Christie, James Conlon), chanteurs (Renée Fleming, Laurence Dale), compositeurs (Philippe Fénelon), directeurs de salles (Thierry Fouquet, Alexander Neef, Stefano Pace), danseurs et chorégraphes (Giorgio Mancini) : tous les contributeurs de l’ouvrage ont, de près ou de loin, côtoyé Hugues Gall et livrent leurs visions de l’homme, faites d’anecdotes, de souvenirs intimes, d’hommages respectueux, de témoignages reconnaissants, contribuant ainsi chacun, par touches successives, à l’élaboration d’un portrait collectif. Celui d’un homme qui aura indiscutablement marqué le milieu lyrique et chorégraphique au tournant du siècle.
—————————————————–