La vie de Maria Callas a fait l’objet de trop nombreux articles, ouvrages, documentaires pour que nous y revenions en détail. Aussi nous contenterons-nous d’indiquer ici quelques jalons essentiels dans la carrière de celle qui fut sans aucun doute la diva la plus célèbre du XXe siècle – et l’une des cantatrices les plus importantes de l’histoire du chant-, avant de décliner son art du chant et de la scène en dix points…
Chronologie
1923
2 décembre
Naissance de Maria Callas à New York
→ À trois ans, avec ses parents et sa sœur Jackie

1937
Maria Callas rentre en Grèce avec sa mère. Elle s’inscrit au conservatoire d’Athènes l’année suivante.

1938
11 avril
Premier récital public à Athènes
→ Callas à 16 ans
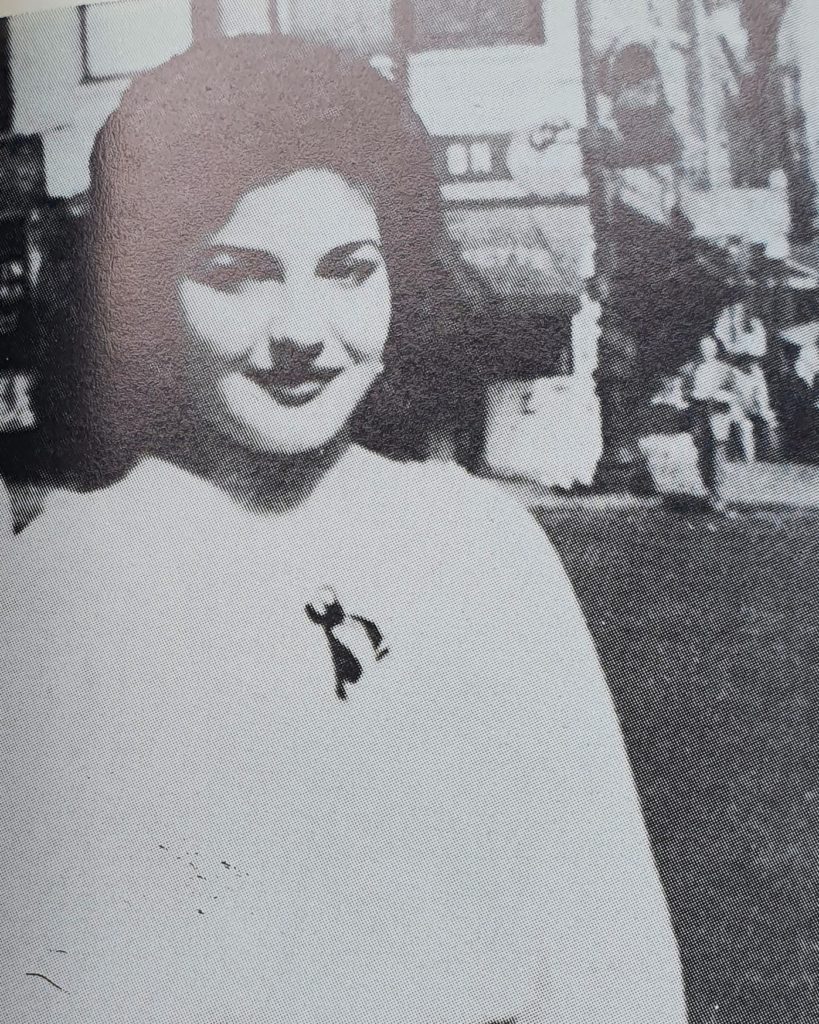
1939
2 avril
Premier rôle sur scène (à 16 ans !) : Santuzza dans Cavalleria rusticana (Athènes)

1941
4 juillet
Première Tosca à Athènes
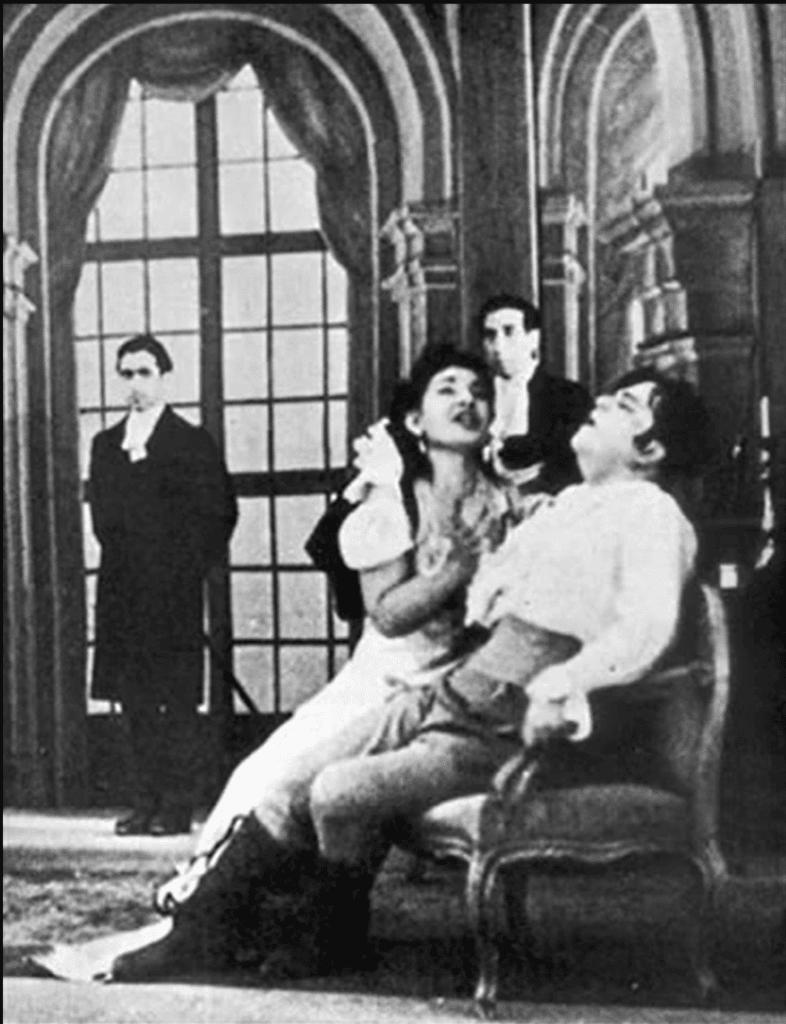
Photo : capture d'écran vidéo YouTube
1944
Printemps
Tiefland (Athènes)
14 août
Fidelio (Athènes)

Photo : capture d'écran vidéo YouTube
1947
27 juin
Arrivée de Callas en Italie
2 août
La Gioconda à Vérone (dir. Serafin)
30 décembre
Tristan et Isolde à La Fenice de Venise (dir. Serafin)
→ Callas en Gioconda

Photo : capture d'écran vidéo YouTube
1948
30 novembre
Norma à Florence
→ Callas en Norma

Photo : capture d'écran vidéo YouTube
1949
Janvier
La Walkyrie et I Puritani à Venise
Décembre
Nabucco au San Carlo de Naples
→ Abigaille dans Nabucco
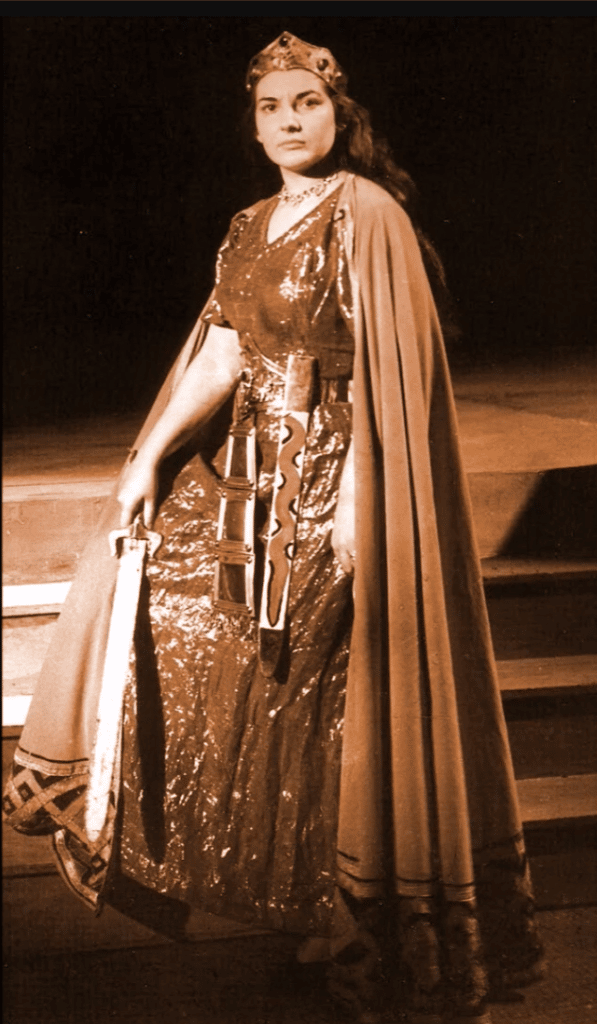
Photo : capture d'écran vidéo YouTube
1950
Mai
Norma à Mexico
Juin
Tosca, Le Trouvère à Mexico
Novembre
Parsifal à Rome
→ Première Leonora du Trouvère à Mexico

Photo : capture d'écran vidéo YouTube
1951
26 mai
I Vespri Siciliani de Verdi à Florence (dir. Erich Kleiber)
Juillet
Traviata à Mexico
7 décembre
I Vespri Siciliani, Milan
→ Les Vêpres siciliennes à Milan le 7 décembre 1951

Photo : capture d'écran vidéo YouTube
1952
Avril
Armida à Florence
7 décembre
Macbeth à Milan
→ Callas en Lady Macbeth

Photo : capture d'écran vidéo YouTube
1953
Février
Le Trouvère à Milan
Mars
I Puritani à Milan
7 décembre
Médée à Milan (dir. Bernstein)
→ Callas en Elvira des Puritani

Photo : capture d'écran vidéo YouTube
1954
4 avril
Alceste à Milan (dir. Giulini)
12 avril
Don Carlo (Milan)
7 décembre
La Vestale à Milan (Première collaboration artistique avec Visconti)
→ Don Carlo

Photo : capture d'écran vidéo YouTube
1955
Mars
La Sonnambula à Milan (dir. Bernstein, mise en scène Visconti)
Mai
La Traviata à Milan (dir. Giulini, mise en scène Visconti)
Septembre
Lucia di Lammermoor à Berlin (dir. Karajan)
7 décembre
Norma à Milan
→ Callas avec Bernstein à l’occasion des représentations de La Sonnambula, puis dans les habits de Violetta, dans La Traviata mise en scène par Visconti à Milan en 1955
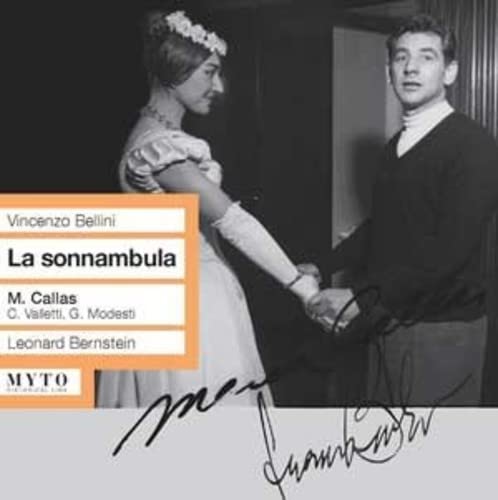
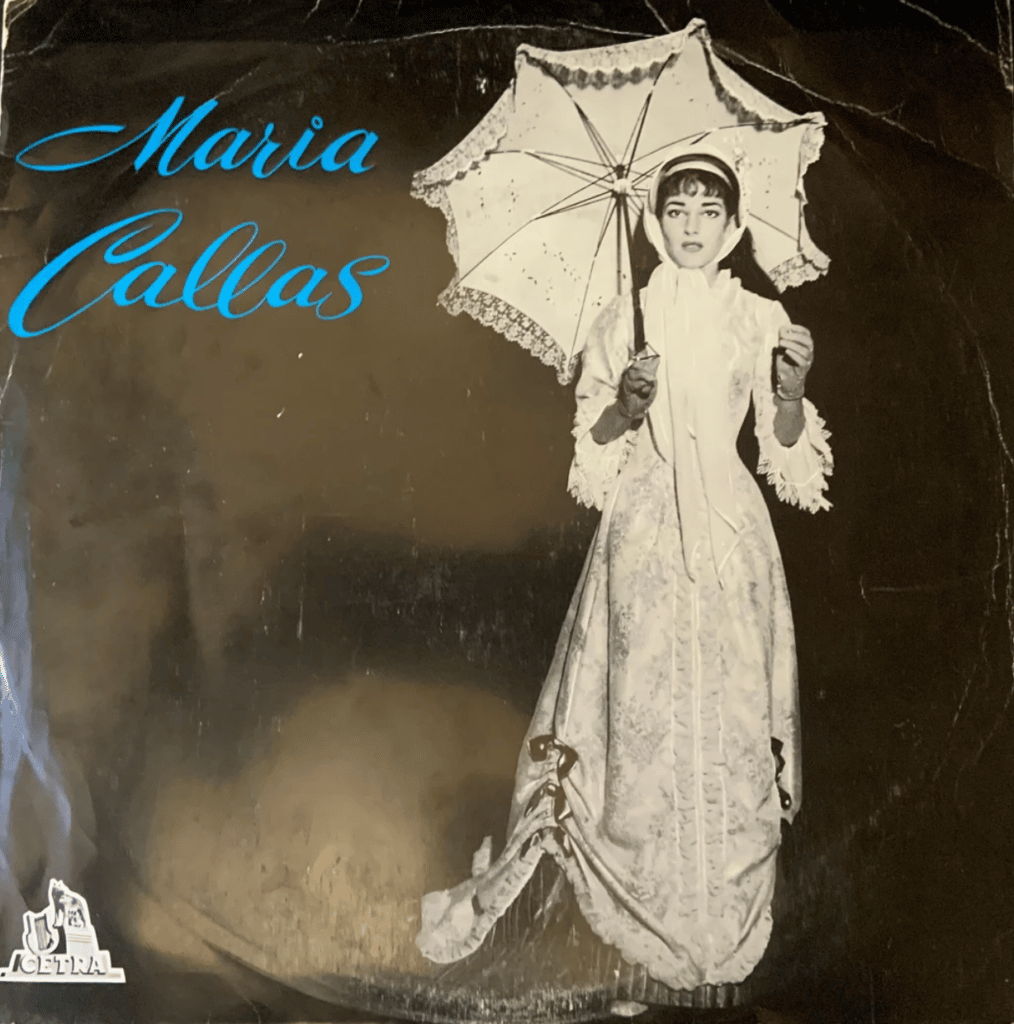
1956
Février
Le Barbier de Séville à Milan (dir. Giulini)
Décembre
Lucia di Lammermoor à New York
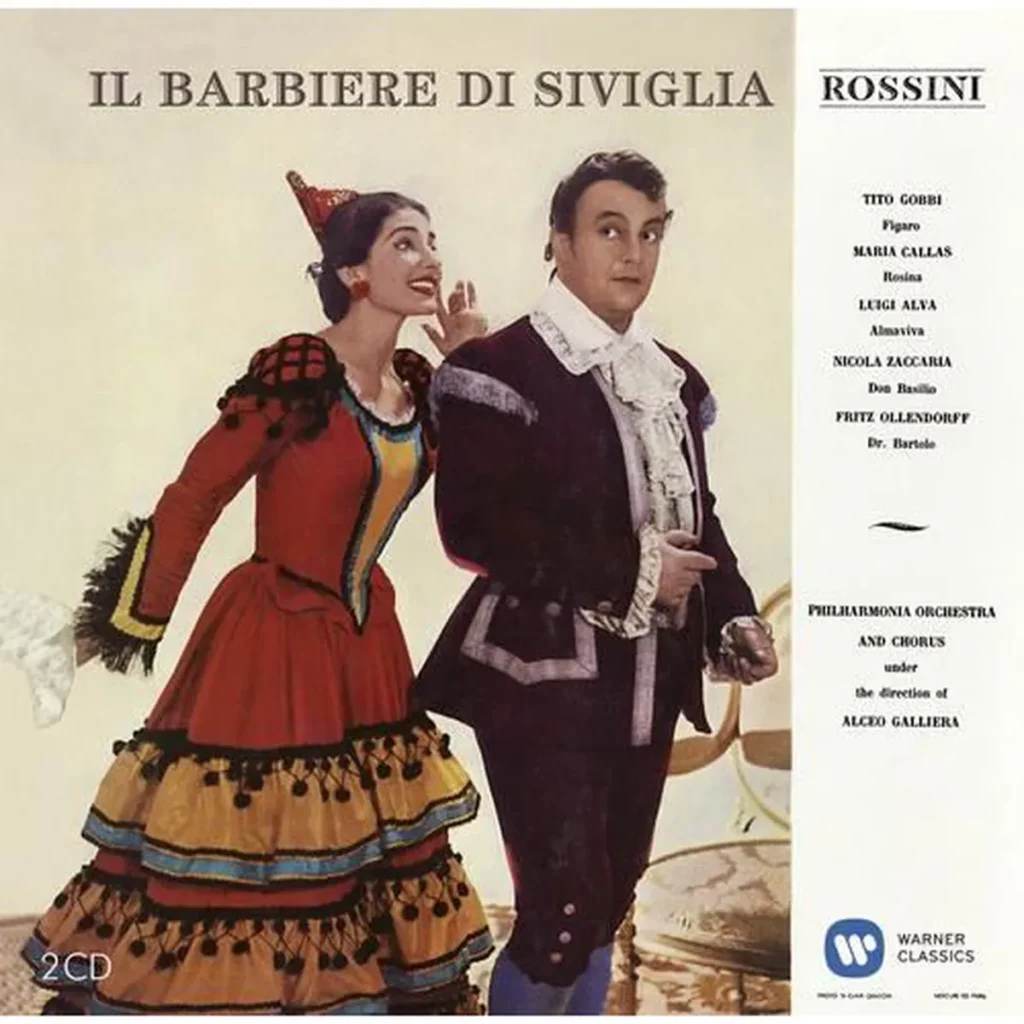
1957
Avril
Anna Bolena à Milan (mise en scène Visconti)
Juin
Iphigénie en Tauride à Milan (dernière collaboration artistique avec Visconti)
Juillet
La Sonnambula à Cologne
Août
La Sonnambula à Edimbourg
7 Décembre
Un Ballo in maschera à Milan
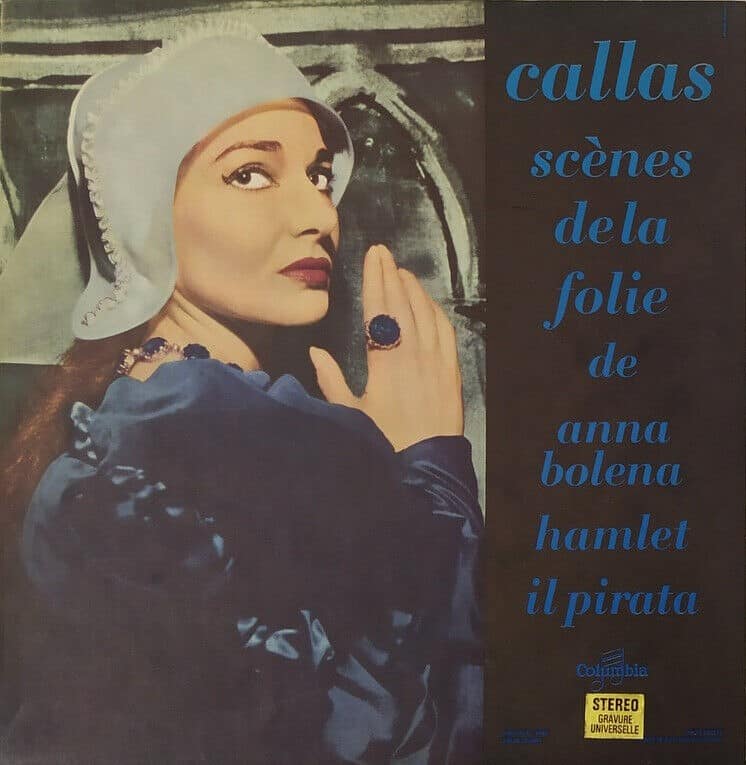
1958
2 janvier
Scandale de la Norma interrompue à Rome
mars
La Traviata à Lisbonne
Novembre
Médée à Dallas
18 décembre
Débuts parisiens
→ Avec Alfredo Kraus dans La Traviata à Lisbonne, puis au Palais Garnier en 1958


1959
Janvier
Il Pirata à New York
7 décembre
Poliuto à Milan
→ Interview à l’issue des représentations de Poliuto

Photos : captures d'écran vidéo YouTube
1961
Décembre
Médée à Milan
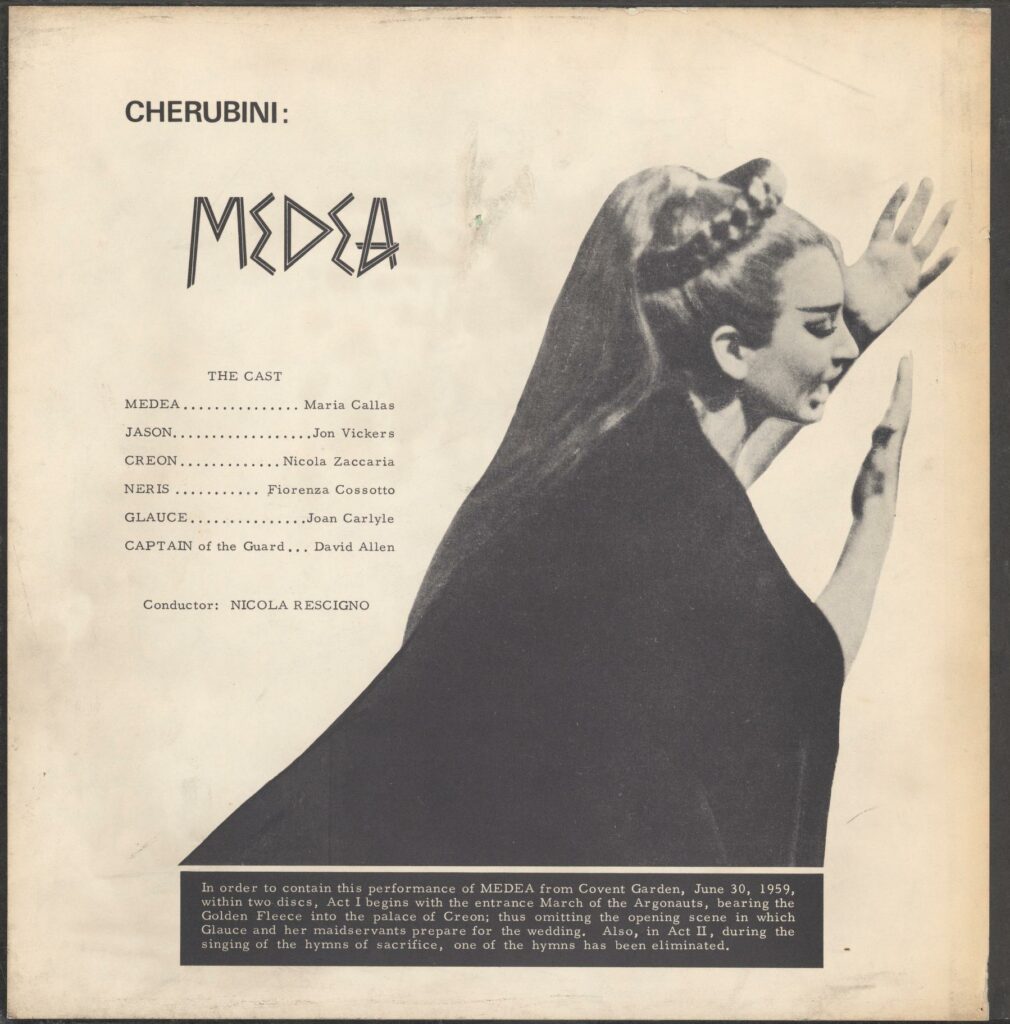
1964
janvier
Tosca à Londres
Décembre
Tosca à Paris
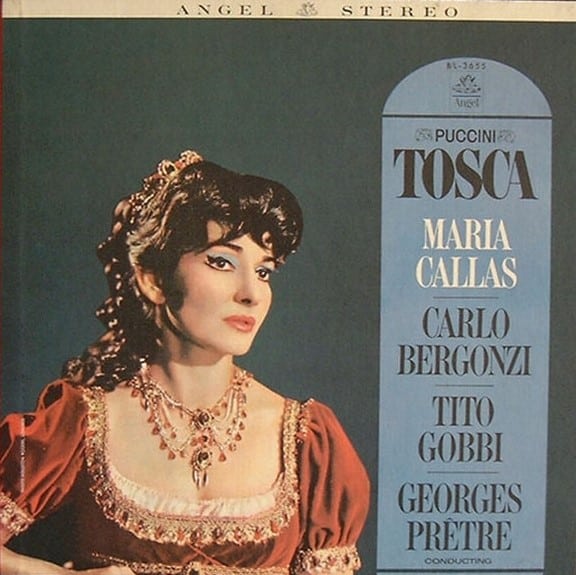

1965
Mai
→ Norma à Paris
1973-1974
Tournée avec Giuseppe di Stefano
→ À Londres en 1973

Photo : capture d'écran vidéo YouTube
1977
16 septembre
Maria Callas meurt d’une crise cardiaque dans son appartement parisien.
→ À Copenhague en récital en 193
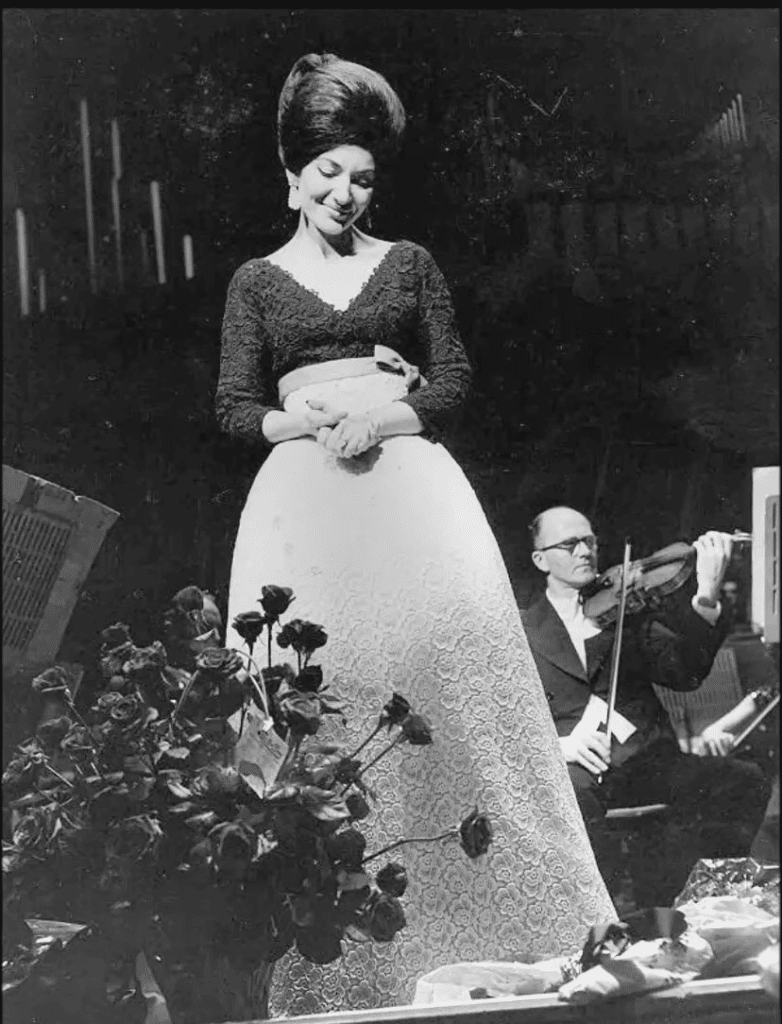
Photo : capture d'écran vidéo YouTube
10 raisons d'aimer Callas
"Qui la voce sua soave..." (Elvira, I Puritani : "Ici, sa douce voix...")
1. Callas ou la voix enchanteresse
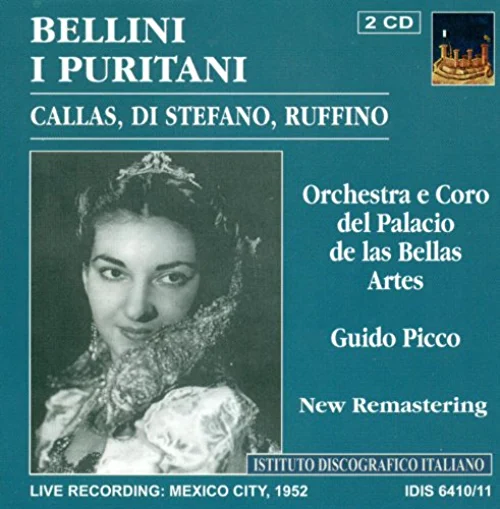
La plus belle voix du monde ? Certainement pas : d’autres timbres sont plus soyeux, et d’une qualité plus égale sur l’ensemble de la tessiture. Il convient cependant de faire ici deux remarques importantes :
- La pure beauté vocale n’a jamais fait, à elle seule, les grands interprètes.
- Il est aussi inexact d’affirmer que Callas avait la plus belle voix du monde que de qualifier sa voix de « laide » : dans ses meilleures années – et au moins jusqu’en 55/56 –, Callas disposait d’un timbre d’une grande beauté et au charme irrésistible. Écoutez, entre autres nombreux exemples, l’attaque de son « D’amor sull’ali rosee » du Trouvère, gravé en 1956 pour Karajan…
Il Trovatore (1956)
"Orsu, Tosca, parlate !" (Scarpia, Tosca: "Et maintenant, Tosca, parlez !")
2. Callas diseuse
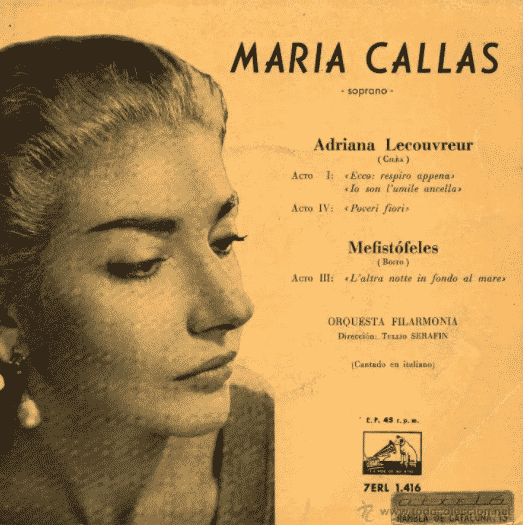
Peu d’artistes ont su comme Callas conférer aux mots toute la teneur poétique ou tout le poids dramatique dont librettistes et compositeurs les ont pourvus. Avec Callas, l’équilibre entre déclamation et chant, mots et musique est constamment préservé, l’un ne prenant jamais l’avantage sur l’autre – l’un et l’autre, au contraire, s’éclairant mutuellement pour délivrer in fine un message bien plus puissant que celui véhiculé par la seule parole ou la seule musique.
Écoutons le « Che tua madre » de Madame Butterfly : le « A guadagnarsi il pane e il vestimento » de Callas, tout empreint de douleur et de honte, son déchirant « Udite la triste mia canzon », ses « Morta ! » glaçants, laissant présager le suicide final de la geisha, sont demeurés inégalés.
Samson et Dalila (1955)
"Come la Tosca in teatro !" (Mario, Tosca : "Comme la Tosca au théâtre !")
3. Callas actrice

Callas et Visconti pendant un entretien avec Pierre Desgraupes à Paris en 1969. Photo : capture d'écran vidéo YouTube
Les témoignages filmés de l’art de Callas sont rares – moins, cependant, qu’on ne l’a longtemps cru. Et ils rendent certainement très imparfaitement compte du charisme qui, au dire de ceux qui ont eu la chance de voir la chanteuse sur scène, émanait de celle que Visconti considérait comme la plus grande actrice depuis Eleonora Duse. Les mains de Callas, dit-on, pleuraient tout autant que sa voix pendant le « Dite alla giovine » de Traviata ; lors de la scène finale de Sonnambula, elle traversait le pont surplombant la rivière dans un état second, comme en apesanteur ; l’entrée de Norma (« Sedicioze voci ») était empreinte d’une grandeur et d’une majesté incomparables : en l’absence de films, nous ne pouvons que fantasmer et rêver ces scènes qui appartiennent désormais à l’histoire de l’opéra. Quelques extraits filmés permettent cependant de comprendre le génie théâtral de celle qui, selon Leonard Bernstein, devenait « de l’électricité à l’état pur » dès qu’elle paraissait sur scène : à Hambourg, en 1959, Callas chante la scène finale du Pirate. Lorsqu’Imogène sombre dans la folie (« Ma il sangue già gronda… », 00:56:49) Callas suggère, par un simple mouvement des bras et l’expression de son regard, le sentiment d’horreur qui envahit le personnage, persuadé de se trouver plongé dans un bain de sang. À Hambourg toujours, mais en 1962 cette fois, Callas, qui vient de chanter le rondo final de Cenerentola, s’apprête à attaquer le « O don fatale » d’Eboli – un rôle qu’elle n’interpréta jamais sur scène. Observez comment, dans les quelques secondes qui séparent les deux airs, la chanteuse passe d’un sourire radieux à l’expression du tragique le plus aigu. Saisissant. (01:49:30)
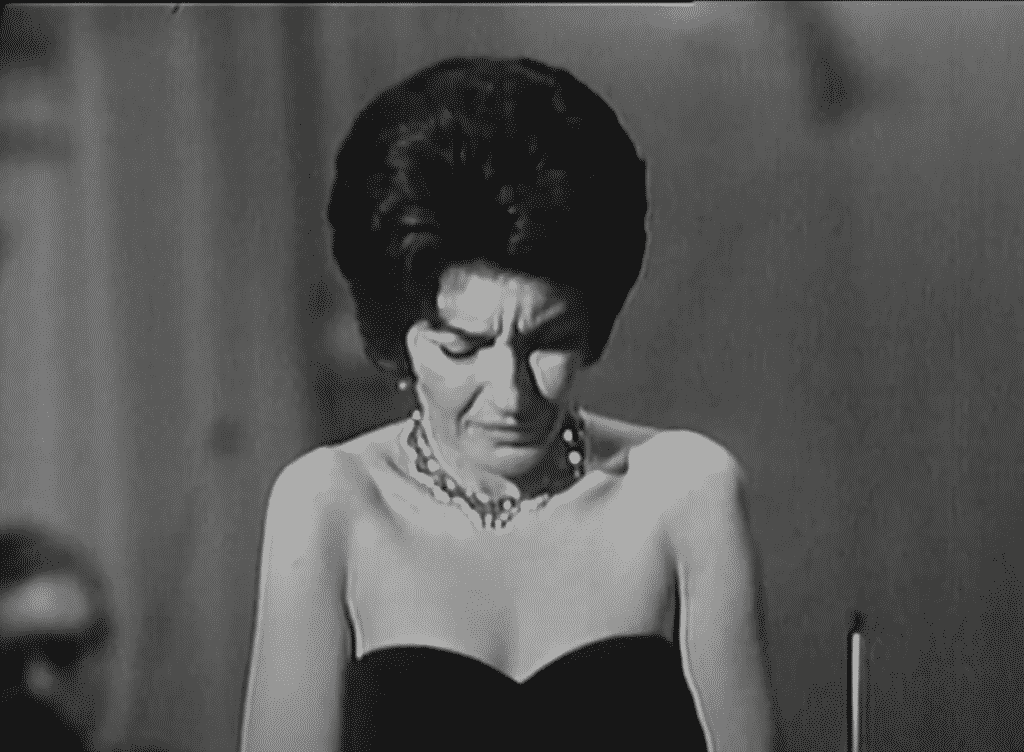

En récital à Hambourg en 1962 - Photos : captures d'écran vidéo YouTube
Les concerts de Hambourg (1959 et 1962)
IL CONTE
Se non vi spiace
un poco di lezione
di Don Basilio invece vi darò./
ROSINA
Oh, con mio gran piacere la prenderò !
(Le comte : S'il vous plaisait, je vous donnerais leçon à la place de Don Basilio. / Rosine : Je la prendrai avec grand plaisir!)
4. Callas technicienne

Photo : capture d'écran vidéo YouTube
N’en déplaise à Renata Scotto qui aime déclarer que Callas n’était pas une bonne technicienne, notre diva possédait une technique hors pair, qui faisait dire à son professeur Elvira de Hidalgo, à qui la jeune Maria avait demandé si elle pourrait faire un jour des pichettati (répétition rapide et staccato d’une note aiguë) : « Si tu continues comme ça, oui ! Tu pourras faire tout ! »
Pour apprécier l’incroyable maîtrise technique de Callas, écoutons-la dans le boléro des Vêpres siciliennes, où se succèdent chant legato, notes piquées, trilles impeccables, vocalises ascendantes et descendantes, le tout couronné par un stupéfiant contre-mi ! Ou encore dans la scène finale de La Somnambule, tellement ébouriffante que le public très comme il faut d’Edimbourg perd littéralement la tête en 1957, et noie l’orchestre et les chœurs sous un déluge d’applaudissements pendant les dernières mesures de l’œuvre !
I Vespri siciliani (1954)
La Sonnambula (Edimbourg, 1957)
"Distrutto tutto qui resti, tutto ! (Armida)
5. Callas révolutionnaire
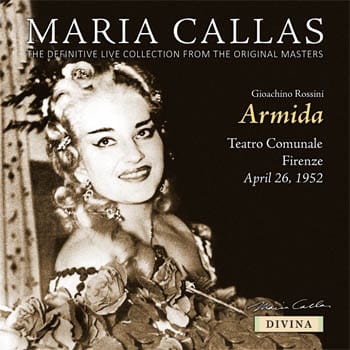
Armida (Florence, 1952)
Avant Callas, le soprano drammatico d’agilità n’était plus qu’un lointain souvenir, le chant colorature étant devenu l’apanage exclusif des sopranos légers. Aussi la surprise d’entendre Bellini, Rossini ou Donizetti confiés à une voix aussi puissante et dramatique fut-elle immense – et c’est peu de dire que Callas ne fit pas immédiatement l’unanimité. Une Turandot, une Tosca était donc capable de chanter aussi Lucia, Rosina, Anna Bolena, Fiorilla du Turco in Italia ? Une Brünnhilde pouvait donc se métamorphoser en Elvira des Puritains ? (Callas chanta à quelques jours d’intervalle La Walkyrie et l’opéra de Bellini à Venise en 1949…). Callas fut ainsi à l’origine de la renaissance du bel canto, un répertoire qui ne survivait plus que par quelques titres, le plus souvent interprétés avec un style parfaitement inadapté.
Aujourd’hui encore, malgré un son très fantomatique, le « Sempre libera » (Traviata) de Mexico (1950) ou la scène finale de l’Armida de Rossini (Florence, 1952) laissent pantois : comment un gosier à la puissance quasi wagnérienne a-t-il pu à ce point respecter l’écriture virtuose de Verdi ou Rossini ? Armida, en particulier, n’a plus jamais retrouvé d’interprète de cet acabit, toutes les chanteuses s’étant depuis risquées dans le rôle faisant figure d’écolières appliquées en comparaison de cette interprétation incandescente.
La Traviata (Mexico, 1950)
Armida (Florence, 1952)
Oh ! Che scena !... Me la godo ! (Fiorilla, Il Turco in Italia : "Oh ! Quelle scène ! Comme je m'amuse !"))
6. Callas comique
Il Barbiere di Siviglia (Milan, 1956)
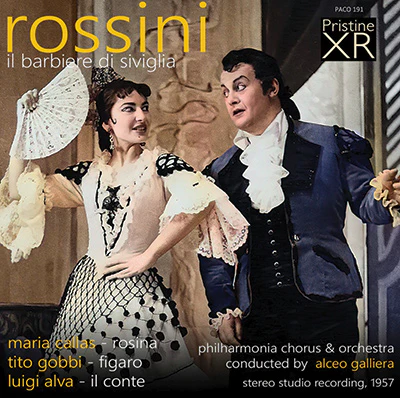
Callas la travailleuse forcenée, la perfectionniste, l’écorchée vive, n’avait peut-être pas un tempérament foncièrement comique. Elle aimait rire cependant, et n’était pas dépourvue d’un certain sens de l’autodérision : le 20 avril 1969, elle s’esclaffe en voyant l’humoriste Claude Vega (venu à sa demande) l’imiter dans l’émission L’Invité du dimanche. Et à deux reprises, elle s’illustrera sur scène, avec succès, dans des rôles bouffes : il s’agit de deux emplois rossiniens, la Fiorilla du Turc en Italie (abordée à Rome en 1950 et reprise à la Scala en 1955), et la Rosine du Barbier (Milan, 1956). Deux incarnations qui ont fait l’objet d’intégrales discographiques.
Il Barbiere di Siviglia (Paris, 1958)
"Son rispettosa !" (Rosina, Il Barbiere di Siviglia : "Je suis respectueuse !")
7. Callas styliste

Photo : capture d'écran vidéo YouTube
À force de travail, mais grâce aussi, sans doute, à une intuition géniale, Callas donnait l’impression de s’approprier naturellement le style exact des œuvres qu’elle interprétait, faisant revivre l’âge d’or du premier ottocento, ou conférant au répertoire italien plus tardif (à Giordano, ou encore à Puccini et à ce que Callas appelait son « malcanto ») une dignité dont certains le jugent dépourvu.
En 1969, avec une voix pourtant déchirée, elle interprète l’air de Medora du Corsaro de Verdi (une œuvre alors parfaitement oubliée) avec une rigueur stylistique admirable, conférant à la page son exacte pulsation rythmique, le panel de couleurs requis, l’expression d’une mélancolie sobre et poignante.
Andrea Chenier (1954)
Il Corsaro (1969)
"Ma dimmi, altra voce non parti d'udire ?" (Lady Macbeth, Macbetto : "Mais dis-moi, ne te semble-t-il pas entendre une autre voix?...")
8. Callas mezzo ?
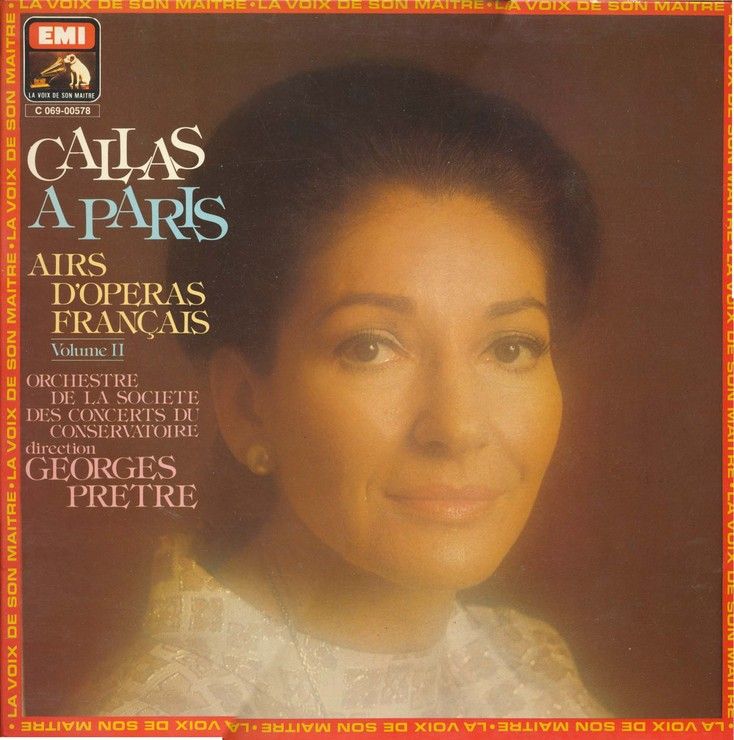
Au tournant des années 1960, Callas, en pleine crise vocale, travaille pour tenter de retrouver ses moyens et tente d’élargir son répertoire en chantant, au concert et au disque, plusieurs airs extraits de rôles de mezzo. En gravant les albums Callas à Paris, dans lesquels Charlotte et Dalila côtoient Marguerite et Leila, l’objectif est double : d’une part, tenter de rééditer l’exploit du récital de 1954, dans lequel Callas faisait alterner des rôles lyriques ou dramatiques (Butterfly, Liù, Turandot, Manon Lescaut) et d’autres ressortissant au registre de soprano léger colorature (Dinorah, Lakmé) ; d’autre part, s’essayer à des rôles vocalement plus graves, avec à la clé, peut-être, la perspective de les interpréter un jour sur scène… Ce ne sera hélas jamais le cas, mais Callas se montre ici capable de graves poitrinés impressionnants et laisse des interprétations très convaincantes des trois airs de Dalila, ou encore une ballade du Roi de Thulé, un air des lettres de Werther superbement phrasés et très touchants…
Samson et Dalila (1961)
"Figli miei, miei tesor, Lungi a voi il reo destin mi chiama! (Medea : "Mes enfants chéris, loin de vous, mon destin funeste m'entraîne !")
9. Terreur et pitié : Callas ou la grandeur tragique

Médée (Pier Paulo Pasolini, 1969). Photo : capture d'écran vidéo YouTube
Écorchée vive, la chanteuse semble se consumer en interprétant des personnages de femmes torturées, blessées à mort. Le génie de Callas leur confère une dignité, une grandeur, une épaisseur tragiques, certes présentes chez Iphigénie ou Médée, plus inattendues chez la Marguerite de Goethe (interprétations poignantes entre toutes de « L’altra notte in fondo al mare », à Londres, en 1959 et surtout en 1961 : l’enregistrement est tronqué et le son est imparfait, mais il s’agit là de l’un des enregistrements les plus bouleversants de Callas ) ou l’Odabella d’Attila : en 1964 (et même en 1969 !), avec une voix pourtant très abîmée, Callas érige un personnage qui pourrait n’être qu’une simple silhouette en authentique figure tragique…
À écouter absolument également: son « Ritorna vincitor » d‘Aida, gravé en 1964 sur un coup de tête, après avoir entendu l’enregistrement de la même page que venait de réaliser Crespin et qu’elle jugeait dépourvu de tout dramatisme. De fait, les premiers mots prononcés par cette Aida déchirée, confrontée à l’essence même du tragique (un dilemme face auquel elle se révèle incapable de prendre quelque décision que ce soit), glacent littéralement le sang !
Mefistofele, Londres, 1961
Attila (1964)
Aida (1964)
""Laisse couler mes larmes..." (Charlotte, Werther)
10. Callas et le pathos

Paris, 1958. Photo : capture d'écran vidéo YouTube
La voix de Callas porte en elle toutes les blessures, toutes les douleurs de l’âme humaine. Personne mieux qu’elle ne sait mouiller son chant de larmes et donner l’impression de pleurer en chantant, sans jamais pourtant se défaire de la plus parfaite musicalité, sans sombrer dans un expressionnisme hors propos.
Écoutez le long récitatif d’Amina avant le sublime « Ah non credea » de La Somnambule : Schwarzkopf (qui, faut-il le rappeler, a renoncé à Traviata immédiatement après avoir entendu Callas dans ce rôle), a souvent déclaré que la Divine y faisait quelque chose de proprement miraculeux… Un miracle qui se reproduit dans le « O nume tutelar » de La Vestale, le « Dite alla giovine » de Traviata (à Lisbonne, en 1958, Callas ferait pleurer les pierres…), le « Deh, non volerli vittime » de Norma (sublime version EMI de 1960, ou, de Norma toujours, le « Teneri figli » : celui de Rome en 1955, porté par un souffle infini et se brisant sur un sanglot, est à pleurer…
Le finale de Norma dans l'enregistrement de studio en1960
Norma, début du second acte, Rome (1955)





2 commentaires
Bonjour,
Passionnée d’art lyrique, et de la Diva , je suis pleinement d’accord avec vos écrits . J’ai eu la chance , de rencontrer Callas, quand j’étais petite à Garnier grâce à ma mère qui chantait à l’Opera , pendant 28 ans , et fut imprégnée de musique et de lyrique. Cette femme était touchante , pleine d’émotions …..
Merci pour votre message chère Catherine. J’aurais tellement aimé voir Callas sur scène ou même, simplement, la croiser. Mais le fait de ne l’avoir jamais vue entretient pour moi, finalement, sa légende ! Même si le regret de ne l’avoir jamais vue restera toujours là…