Pompeo Magno, Genève, 28 septembre 2025
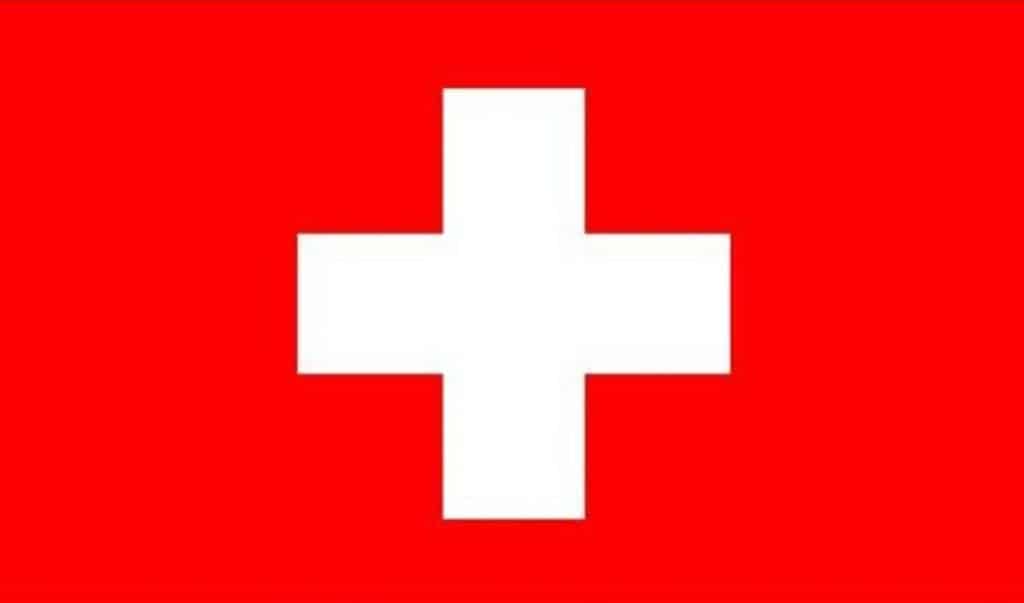
Après les représentations triomphales à Bayreuth du 4 au 14 septembre dernier, l’ultime chef-d’œuvre de Cavalli débarque à la Cité bleue de Genève. Sans mise en scène, mais avec un sens du théâtre achevé, la musique sublime du Vénitien, le jeu des interprètes et la conduite magique du Maestro Leonardo García Alarcón assurent un nouveau triomphe.
Le chef argentin l’a avoué : son rêve est de monter les 27 opéras du plus grand génie vénitien du Seicento. Après quatre opus et un disque anthologique, et avant d’autres projets cavalliens, Pompeo Magno révèle un nouveau chef-d’œuvre qui, après sa résurrection bavaroise, entame sa tournée à Genève, avant Paris et Vienne (et une possible reprise de la version scénique). La jauge réduite (300 places) et l’acoustique exceptionnelle de la salle font de la Cité bleue l’écrin idéal pour cet opéra tardif de Cavalli (ce sera le dernier triomphe qu’il connaîtra de son vivant), représenté en 1666, et qui témoigne d’un fléchissement de la veine tragi-comique en direction d’une moralisation de l’intrigue. Le protagoniste n’est plus un anti-héros (comme Néron, Caligula ou Héliogabale), soumis à ses passions, mais un héros, membre du triumvirat (avec Crassus et César), vainqueur de Mithridate, qui fera preuve in fine de magnanimité et de générosité envers le roi du Pont et son fils Pharnace, à qui il restituera son royaume. Malgré ce fléchissement esthétique (l’opéra clôt une trilogie romaine précédée de Scipione africano et Muzio Scevola qui attendent à leur tour une résurrection), Pompeo Magno est bien un opéra vénitien, avec ses personnages comiques, ses intrigues amoureuses (Servilio aime Giulia aimée par Pompeo, quand Issicratea aimée d’un amour réciproque par Mitridate est courtisée par Sesto qui se lamente d’être rejeté par « un cœur de glace entre deux collines de neige » et aussi par le désir concupiscent de Claudio, fils de César), son atmosphère nocturne et ses identités cachées ; l’hybris n’est jamais loin qui sert précisément à la raison d’en éviter les excès, annonçant ainsi l’opéra réformé (Minato, le librettiste, ira offrir ses services à la cour de Vienne, précédant Métastase dans la tentative de refonder l’opéra dans un sens plus moral).
Forts de l’expérience scénique à Bayreuth, et avec une distribution légèrement modifiée (pour les rôles de Sesto et Giulia), les interprètes ont donné une version concertante qui n’en est pas vraiment une : ils chantent par cœur, évoluent sur scène, munis de quelques accessoires idoines qui aident à les identifier. Le théâtre est bien là, et si le recitar cantando est très présent et demeure la forme musicale privilégiée du dramma per musica vénitien, les formes closes ne manquent pas, en particulier les lamenti, nombreux, très expressifs, d’Issicratea, de Farnace, de Giulia (« Alpe gelide »), qui arracheraient des larmes aux pierres, tandis que les ariette enjouées d’Atrea ou d’Arpalia, ou l’irrésistible « Rendimi la mia pace » de Claudio, en clôture de la première partie (milieu du deuxième acte) ont comblé un public définitivement conquis. Le théâtre musical de Cavalli est un théâtre des passions humaines, et si l’on ne voit pas passer les plus de trois heures de musique, agrémentées judicieusement de quelques pièces musicales, de Cavalli lui-même (la sonate célèbre en guise d’ouverture) ou de Grillo dont la sublime sonata da chiesa apporte une solennité de circonstance, on se met à regretter la douzaine de scènes sacrifiées (sur soixante que compte l’opéra) nous privant d’une bonne heure de musique supplémentaire, sans que la cohérence de l’ensemble en soit toutefois le moins du monde entamée.
La distribution venue, à deux exceptions près, de Bayreuth, frise l’idéal. Dans le rôle-titre, Max Emanuel Cencic allie élégance du phrasé, timbre solide et bien projeté et atteint au sublime dans son air solennel qui ouvre le deuxième acte, « Incomprensibil nume », débutant recto tono, avant que la mélodie proprement dite s’installe, soutenue par l’orchestre qui en magnifie l’intensité : du pur Cavalli ! Le chant de Mariana Flores dans le rôle musicalement magnifique d’Issicratea est toujours aussi captivant, dans cette alliance rare entre puissance de projection et extrême raffinement de la ligne vocale ; son engagement scénique et son sens aigu du théâtre ne sont plus à démontrer tant elle incarne à la perfection l’appropriation de la parole poétique réceptacle des affects : son « Sposo amato, e dove sei », parmi de nombreux autres exemples, est une pièce d’anthologie. Valerio Contaldo campe un superbe Mitridate à qui échoit de nombreux airs plaintifs, mais sait aussi émouvoir dans l’élégie (superbe canzonetta du I, accompagnée à la guitare « Coetaneo con gl’astri »). Son fils Farnace est incarné par le contre-ténor allemand Aloïs Müllbacher, au timbre brillant, chaleureux, à l’émission claire, et à l’apparence juvénile qui sied bien au rôle qu’il représente ; l’abondance de ces voix dans la distribution (pas moins de six chanteurs) eut pu faire craindre une relative homogénéité vocale, il n’en est rien, même si l’on peut regretter un léger manque de personnalité vocale chez Logan Lopez Gonzalez qui reprend avec détermination et courage le rôle important de Sesto tenu par l’excellent Niccolò Balducci, retenu à Wexford. Sans bénéficier de l’expérience de la scène, il a donné le change et relève brillamment le défi, non seulement en chantant par cœur, mais en faisant preuve d’un bel engagement scénique (la scène de l’ivresse et les lamenti sont impeccablement interprétés), tout en mettant à profit un timbre qui s’est étoffé avec les années, plus consistant et plus charnu, ce qui rend plus fluide l’intelligibilité du texte. Valer Sabadus dans le rôle de Servilio a gardé les traces de son personnage dégingandé dans la posture qu’il adopte sur scène : un timbre un peu léger qui se déploie avec davantage de force dans le registre aigu et dont la projection limitée dans le medium est compensée par l’acoustique avantageuse de la salle. Sa fiancée Giulia a les traits et la voix de Lucía Martín-Cartón qui remplace Sophie Junker, également retenue à Wexford. Sa voix moins ample mais au phrasé raffiné est soutenue par une réelle présence scénique et une intelligence du texte sans faille (magnifique « Se un tormento » au 2e acte). Les autres membres du triumvirat sont impeccables, le César de Victor Sicard et le Crasso de Jorge Navarro Colorado, rivalisent d’assurance, l’un baryton, l’autre ténor, malgré l’absence d’airs, en partie sacrifiés dans les coupures. Le Claudio de Nicholas Scott est de ce point de vue mieux servi : son obsession sexuelle impacte son jeu scénique comme le style de son chant, à la fois constamment tendu, comme le sexe en érection qui le caractérise dans la version scénique, et légèrement tremblotant qui dit la puissance irrépressible du désir ; non moins lubrique ou du moins lascive l’Arpalia de Kacper Szelazek, autre contre-ténor habitué des productions du chef argentin : sa voix perchée, son sens non moins aigu du théâtre, sa vitalité exubérante prendront fin avec son assassinat, cause des malheurs de Mitridate. Enfin le couple Atrea / Delio trouve une remarquable incarnation, la première à travers la voix et la présence truculentes de Marcel Beckman : ses moyens, qui semblent illimités, loin de paraître excessifs, sont en parfait accord avec la folie du personnage, mais révèlent aussi la place importante que représente ce rôle typiquement vénitien, sorte de faire-valoir moral qui intervient souvent en fin d’acte pour ramener la vaine gloriole des puissants à des considérations plus bassement matérielles. Dans le rôle de son souffre-douleur Delfo, le vétéran Dominique Visse ne semble donner aucune prise au temps : sa voix est toujours aussi délicieusement flûtée et d’une grâce diaphane qui impressionne.
Dans la fosse, Leonardo García Alarcón dirige son ensemble Cappella Mediterranea avec jubilation, avec délectation et un sens époustouflant du théâtre : il ne dirige pas que ses musiciens, mais l’œuvre tout entière, tant l’osmose entre la fosse et la scène force l’admiration. S’il a étoffé l’orchestration (percussions et vents en particulier), pour donner plus de corps et de matière à cette « muette éloquence » qu’est la musique, il rappelle implicitement par là d’une part que le théâtre chez Cavalli est aussi bien sur scène que dans la fosse, d’autre part que cette ultime partition, notée en cinq parties, est l’une des plus riches musicalement du compositeur (qui réalisa lui-même, chose assez rare pour le signaler, la musique des ballets). Pompeo Magno est un perpétuel enchantement que l’on souhaite voir et revoir encore. On se consolera avec la captation vidéo disponible pendant un an sur Arte.tv.
Pompeo Magno : Max Emanuel Cencic
Sesto : Logan Lopez Gonzalez
Mitridate : Valerio Contaldo
Issicratea : Mariana Flores
Farnace : Aloïs Mühlbacher
Arpalia : Kacper Szelazek
Cesare / Principe cavaliero : Victor Sicard
Claudio : Nicholas Scott
Giulia : Lucía Martín-Cartón
Servilio : Valer Sabadus
Crasso : Jorge Navarro Colorado
Atrea : Marcel Beckman
Delfo : Dominique Visse
Cappella Mediterranea : dir. Leonardo García Alarcón
Mise en espace : Max Emanuel Cencic
Pompeo Magno
Opéra de Francesco Cavalli sur un livret de Nicolò Minato, créé au théâtre San Salvatore de Venise le 20 février 1666.
Genève, La Cité Bleue, représentation du 28 septembre 2025.










1 commentaire
A Paris, c’est malheureusement devant un Théâtre des Champs Élysée rempli à 60% que la soirée du 1er octobre déployait les fastes de cet opéra si bien évoqué par Jean-François Lattarico. La distribution était la même qu’à Genève et il y a peu à ajouter par rapport au compte-rendu ci-dessus. Si ce n’est peut-être que j’ai trouvé la voix de Max Emmanuel Cencic moins projetée qu’elle ne fut et que, de fait, Aloïs Müllbacher et Logan Lopez Gonzalez lui volaient la vedette. Mariana Flores fut au diapason de sa réputation avec un sens du théâtre qu’on lui connait et une ampleur, un fruité vocal en tout point splendides. Valerio Contaldo était un Mithridate bouleversant et toute la distribution méritait les plus grands éloges par leur engagement et la liberté totale qui se dégageait d’une représentation semi-scénique où l’espace du TCE était utilisé comme sait le faire Leonardo Garcia Alarcon. Toutes et tous s’amusaient et s’investissaient totalement dans cette soirée jouissive, tour à tour joyeuse et poétique. Triomphe public plus que mérité pour des artistes dégageant un esprit de troupe sous la direction impériale de leur chef, toujours aussi investi dans chaque moment, chaque note. Une soirée de pur bonheur musical et théâtral !