Genève ouvre sa nouvelle saison avec le DON CARLOS version française en 5 actes

Don Carlos, Grand Théâtre de Genève – 15 septembre 2023
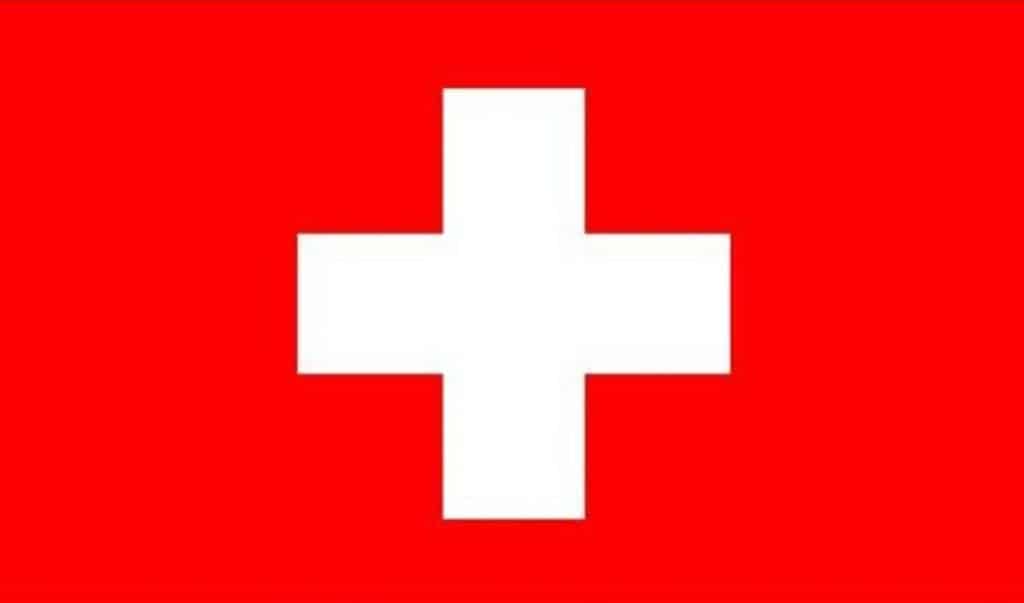
Une très belle réussite musicale, mais une lecture scénique inégale, qui questionne la modernisation à tout prix d’un événement historique.
Don Carlos tel qu’ont pu le découvrir les spectateurs français en 1867
L’an dernier, la saison du Grand Théâtre s’ouvrait sur La Juive, dont les thèmes sont le fanatisme et l’intolérance religieuse. Cette année, sous le titre « Jeux de pouvoir », la nouvelle saison genevoise débute avec un autre grand opéra dominé par l’ingérence de la religion dans les affaires politiques et de la politique dans les affaires personnelles : Don Carlos, l’opéra qui ouvrira la saison à la Scala en décembre, là dans la version italienne, ici dans la version originale française complète en cinq actes, ballet inclus. Un titre tourmenté sur lequel Verdi reviendra plusieurs fois, nous laissant de nombreuses versions, chacune avec ses mérites et ses défauts : dans cette première version, la complexité des thèmes exposés justifie les quatre heures et demie de représentation, avec un seul entracte, mais les coupes effectuées dans les versions suivantes rendront l’œuvre plus efficace du point de vue dramaturgique.
Nous voyons ici l’opéra tel qu’il a été écrit pour l’Exposition universelle de 1867 à Paris, avec laquelle Verdi est revenu à son auteur préféré, Friedrich Schiller, pour mettre en musique son Dom Karlos, Infant von Spanien de 1787, un drame qui incarnait parfaitement l’esprit du Sturm un Drang avec son contraste entre Rodrigo, marquis de Posa, symbole de liberté et de tolérance, et l’absolutisme monarchique de Philippe II d’Espagne. Verdi aimait le contraste entre parents et enfants, ainsi que le conflit entre l’État et l’Église, incarné ici par le personnage du Grand Inquisiteur. La liberté de traitement des faits historiques au profit de la complexité des personnages a conduit Verdi à écrire une œuvre où le degré d’élaboration des pages musicales et le souffle donné à l’orchestration font de Don Carlos un chef-d’œuvre absolu.
Une très belle réussite musicale
À Genève, pour la troisième fois consécutive après Les Huguenots de Meyerbeer et La Juive d’Halévy, Marc Minkowski dirige un « Grand Opéra » français : Don Carlos. Il aborde le titre verdien avec une direction précise et riche en couleurs mais dépourvue de toute exagération : les contrastes sonores ne sont jamais poussés à l’excès, bien au contraire. Sous sa direction, l’orchestre de la Suisse Romande s’exprime avec douceur, les sons des bois et des cordes ont une élégance et une clarté transparentes, le drame n’est pas explicité par le volume sonore, mais par la tension se greffant sur un discours musical toujours fluide et sans aspérité. Le chœur, protagoniste essentiel de ce drame, constitue un instrument ductile et expressif, qu’il s’agisse du peuple opprimé par la guerre dans le premier acte, ou des chants de deuil des religieux.
La distribution regorge de fortes personnalités, du merveilleux Stéphane Degout, Rodrigo sensible à la grande projection et à l’articulation parfaite, à l’Elisabetta de Rachel Willis Sørensen à la voix riche en nuances et au timbre particulièrement doux. Charles Castronovo est un Don Carlos à la présence vocale et scénique sûre, qui tente de donner de la profondeur à un personnage qui n’est pas passionnant. Une certaine intempérance expressive de la part de Dmitrij Ul’ianov transforme son Philippe II en despote aux traits parfois vulgaires (ne serait-ce que par le choix de la metteuse en scène, comme nous le verrons), avec un grave puissant mais une diction discutable où l’accent slave prédomine. Ce qui fait défaut, c’est la royauté du personnage et la confrontation avec le Grand Inquisiteur est moins impressionnante qu’à l’accoutumée, notamment en raison de la similitude de son timbre avec celui de la basse Liang Li. La Princesse Eboli trouve en Ève-Maud Hubeaux une interprète de grand tempérament qui sait aussi gérer les exigences du bel canto. Ena Pongrac (Thibault), William Meinert (un moine), Julien Henric (le comte de Lerma), Giulia Bolcato (la voix du ciel) et le sextuor de députés flamands complètent dignement cette riche distribution.
Une lecture scénique inégale
Au cours de son agonie, Philippe II d’Espagne semble regretter de ne pas avoir exterminé plus d’hérétiques… Dans la mise en scène confiée à Lydia Steier, la mise à mort de ceux-ci est présente dès la première scène de l’acte de Fontainebleau avec l’exécution d’un homme qui sera pendu pendant le duo d’amour des deux jeunes gens, et aussi quand arrive la nouvelle que la princesse française est finalement destinée à Philippe. Ensuite, pendant l’autodafé, les six députés flamands s’ajouteront aux cadavres déjà pendus au plafond et, au le finale, Don Carlos et Elisabeth finiront eux aussi la corde au cou.
Le décor choisi par la metteuse en scène germano-américaine transpose l’action du XVIe siècle aux années de la RDA sous le contrôle de la Stasi : déguisés en moines, de nombreux fonctionnaires espionnent les personnages grâce aux interstices creusés dans les murs équipés de micros et d’appareils d’enregistrement. Dans la scénographie de Momme Hinrichs, le gris domine dans une structure rotative omniprésente, dans les vidéos en noir et blanc, dans les éclairages obsessionnellement fixes de Felice Ross et dans les costumes lugubres d’Ursula Kudma. Philippe s’habille comme le dictateur d’un régime totalitaire, bottes, pantalon, veste et manteau en cuir noir et couverts de médailles. La dépouille de Charles Quint repose dans une niche dorée qui sert également de console ou même de lit pour Eboli, ayant passé la nuit avec le roi, et trahissant doublement la reine en lui volant son coffret à bijoux. Ce n’est pas une nouveauté dans la mise en scène, mais ici la femme reste présente même pendant « Elle ne m’aime pas », réduisant le puissant monologue à l’emportement/justification d’un mari qui vient de trahir sa femme. Eboli reste en scène, cachée derrière un pilier, même lors de la rencontre ultérieure avec le Grand Inquisiteur, et si l’on compte également les deux accompagnateurs, pas moins de cinq personnes se côtoient dans une scène qui fait pourtant de l’affrontement entre deux personnages solitaires sa grandeur absolue. D’autres défaillances de la mise en scène nuisent également à l’efficacité du drame, comme dans la scène de l’autodafé, où l’on passe et repasse la corde au cou des députés flamands, avec un effet dépourvu de toute dimension tragique, ou dans le finale, peu convaincant dans le livret et encore moins dans la réalisation scénique proposée par Steier. Deux scènes rompent délibérément avec l’atmosphère lugubre de l’histoire : d’abord la scène du jardin avec Eboli et les dames de la reine qui, on ne sait pourquoi, sont amenées à marcher sur des bascules : la plus délicate se voit récompensée après la chanson sarrasine ; puis le ballet du troisième acte, transformé en une orgie à la Eyes Wide Shut avec des participants portant des masques, une structure scénique tournant de façon vertigineuse et un meurtre, totalement gratuit, à la fin.
Il y a quelques jours, le quotidien genevois Le Temps accueillait dans sa rubrique « Débats » un article d’Emiliano Gonzalez Toro intitulé « Quand l’opéra doit réapprendre le respect », dans lequel le chanteur déplore que « trop de metteurs en scène maltraitent les chanteurs, les opéras et le public avec des productions élitistes qui se ressemblent toutes […]. À force de courir après l’anticonformisme et la modernité, le Regietheater apparaît de plus en plus banal, conventionnel, comme une forme d’académisme moderne ». Le ténor suisse donne ainsi la parole à des artistes qui se sentent de moins en moins à l’aise dans des productions qui ne cherchent presque que la provocation et où la vision du metteur en scène est prédominante et ne respecte ni la partition ni le livret. Ce n’est pas le cas de cette production genevoise qui, malgré quelques incohérences et fautes de goût, a rencontré un écho favorable auprès du public, ayant accueilli le spectacle par des applaudissements nourris et chaleureux lors de la première.
Mais… qui sait quand nous pourrons à nouveau assister à une production intelligente et intrigante s’inscrivant dans le cadre temporel de l’histoire et du livret ? Cela devient de plus en plus rare – et souhaitable.
Per leggere questo articolo nella sua versione originale (italiana), cliccare sulla bandiera!
Retrouvez nos interviews de Rachel Willis Sørensen et Ève-Maud Hubeaux, et découvrez ici notre dossier sur Don Carlos.
Don Carlos, Infant d’Espagne : Charles Castronovo
Philippe II, roi d’Espagne : Dmitry Ulyanov
Élisabeth de Valois : Rachel Willis Sørensen
Rodrigue, marquis de Posa : Stéphane Degout
La princesse Éboli : Eve-Maud Hubeaux
Le Grand Inquisiteur : Liang Li
Thibault : Ena Pongrac
Un moine : William Meinert
Le Comte de Lerme : Julien Henric
Une voix céleste : Giulia Bolcato
Les Députés de Flandre : Raphaël Hardmeyer, Benjamin Molonfalean, Joé Bertili, Edwin Kaye, Marc Mazuir, Timothée Varon
La comtesse d’Aremberg : Iulia Elena Surdu
Chœur du Grand Théâtre de Genève (dir. Alan Woodbridge), Orchestre de la Suisse Romande, dir. Marc Minkowski
Mise en scène : Lydia Steier
Scénographie et vidéos : Momme Hinrichs
Costumes : Ursula Kudrna
Lumières : Felice Ross
Dramaturgie : Mark Schachtsiek
Don Carlos
Opéra en 5 actes de Giuseppe Verdi, livret de Joseph Méry et Camille du Locle (d’après la tragédie Don Carlos de Friedrich von Schiller), créé le 11 mars 1867 à l’Opéra de Paris.
Représentation du vendredi 15 septembre 2023, Grand Théâtre de Genève.
