Livre – Jean-Philippe Thiellay : L’Opéra, s’il vous plaît-Plaidoyer pour l’art lyrique
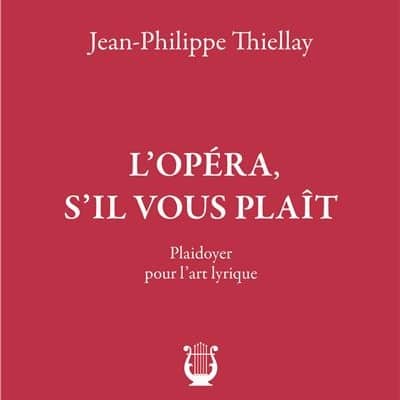
Un ouvrage extrêmement stimulant qui, de toute évidence, fera date…
Alors que l’on referme les quelque deux cent pages de cette stimulante synthèse sur la situation pas forcément très folichonne de l’art lyrique dans le monde en général, et en France, en particulier, c’est au sous-titre du livre que l’on revient tout naturellement : Plaidoyer pour l’art lyrique. Car c’est bien à une plaidoirie à la structure parfaitement équilibrée et maîtrisant tous les attendus de l’exercice que nous invite l’auteur, poliment – dès son titre ! – mais avec une détermination digne de ces héros et héroïnes d’opéras romantiques tant admirés !
Un état des lieux alarmant
Comme dans le grand opéra, genre bien connu de Jean-Philippe Thiellay [1], l’opus est composé en cinq actes avec prologue et coda permettant à l’auteur de dévoiler, au-delà de la thèse défendue, un ouvrage personnel et souvent émouvant auquel vient s’ajouter une sélection bibliographique bienvenue, permettant au lecteur curieux de pousser plus avant la connaissance de domaines aussi divers que le management des maisons d’opéras et leur économie, l’esthétique et l’actualité du genre ou la musicologie…
La thèse justement, quelle est-elle ? En France, au-delà d’une programmation cache-misère pour quelques grandes maisons, le désert menace et l’art lyrique, genre noble s’il en est, pourrait bel et bien disparaître du paysage culturel. Au-delà de toute politique-fiction et d’une crise sanitaire qui n’arrange pas les choses, la crise est plus ancienne et plus profonde : entre hausse des coûts, renouvellement des publics qui ne s’effectue pas ou presque, génération Z bien éloignée d’une pratique et des codes sacro-saints de jadis, directeurs d’opéras « drogués à la subvention » ( environ 64% des ressources des opéras en France, chiffre d’ailleurs très proche du reste de l’Europe) et qui, de saison en saison, courant après d’éventuels mécènes et des moyens de plus en plus restreints, se retranchent souvent dans des pratiques rivées sur le passé ou tournées vers un avant-gardisme peu compréhensible du public, plus rien ne semble tourner rond sur la planète opéra !


La Traviata par Zeffirelli vs Ariane et Barbe-Bleue par Serre
Rien d’étonnant à cela pour l’auteur, tant que l’État et les Collectivités locales, surtout en France, ne se posent pas la question du « sens » à donner aux politiques publiques en faveur de l’art lyrique : quelle volonté à faire Opéra ? Pour quelle utilité ? Pour qui ? Avec quels moyens financiers et humains ?
L’heure de la réinvention
Au-delà du seul genre « Opéra », c’est toute l’industrie du spectacle vivant et de la création, dans un monde mondialisé – ce qui, ici, pourrait être une chance – qui est impactée par cette question du sens devant hic et nunc être posée afin de laisser la porte grand ouverte à d’impératives réponses.
L’heure de la réinvention a donc largement sonné avec l’impératif catégorique, selon l’auteur, de nouvelles formes de relation avec le public, jeune surtout, en créant les contacts et les passerelles indispensables avec d’autres formes artistiques, de nouveaux modes d’expression et de nouveaux artistes (la jeune garde est prête et a de grandes qualités [2]). Les vénérables maisons d’opéras doivent en remontrer à tous car elles demeurent des « hyper-lieux » du XXe siècle (au sens géographique de la notion), c’est-à-dire des lieux transverses de croisement, de passage, d’échange, magnifiant bien sûr la voix humaine et la magie qui l’environne.
La mutation existentielle (rien moins !) dont parle Jean-Philippe Thiellay aura toujours bien évidemment besoin d’un pilier reposant sur les politiques publiques de l’Etat et des Collectivités, entités auxquelles il faudra de plus en plus démontrer l’utilité des deniers versés – la LOLF, loi organique relative aux lois de finances, et sa logique de résultat étant, depuis 2001, passée par là – et, au-delà, le caractère performant et pas du tout décoratif de l’art lyrique. Pas de pessimisme viscéral, cependant, chez l’auteur, bien au contraire (on peut chanter « all’armi ! » avec un enthousiasme communicatif !), car l’art lyrique dispose de nombreux atouts tant par son domaine patrimonial souvent exceptionnel que par le langage simple et direct de la voix, qui « parle » à beaucoup, l’attractivité des stars du lyrique sans oublier la beauté des grandes œuvres du répertoire tout comme celles – créations contemporaines par exemple – pour lesquelles il faudra davantage prendre le spectateur par la main.
Mais entrons un peu plus dans le cœur du sujet.
Opera addict
En guise d’exorde, ou plutôt de prologue, Jean-Philippe Thiellay, ancien directeur général adjoint de l’Opéra national de Paris et depuis lors président du Centre national de la musique, ne fait pas mystère de son « opéraddiction » et, dans ce qui est le moment le plus personnel du livre mais qui n’est pas écrit au seul titre de la nostalgie gratuite d’un ancien combattant de l’afición lyrique, nous parle tout d’abord de ses sorties de jeunesse à l’Opéra de Marseille et de cette sorte de cérémonie – au sens quasi symbolique du terme – qui, longtemps, répondant au même rituel, environna pour lui la représentation d’un opéra. Quid, en effet, aujourd’hui de la préparation lointaine aux ouvrages à l’affiche lorsque le jeune amateur partageait en famille le moment attendu de la découverte non seulement des programmes des saisons à venir mais, presque consubstantiellement, du « avec qui »?
Quid de la préparation directe de l’ouvrage par l’audition comparative à la maison, l’écoute régulière d’émissions cultes (Ah « La tribune des critiques de disques » !), les lectures, depuis l’alors incontournable Kobbé jusqu’au numéro de « l’Avant-Scène Opéra » ?
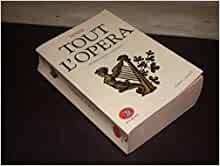
Quid encore de l’après-spectacle et de la sortie des artistes ou l’accès aux loges (lorsqu’on le pouvait…) permettait de rencontrer les interprètes, voire de lier des relations amicales avec certains d’entre eux ? Bien évidemment, l’addiction pouvait aller jusqu’à réaliser de précieux enregistrements « pirates » …dont l’auteur a raison de ne pas se cacher puisque, de toute façon, il y a désormais prescription et que, sans de tels enregistrements, le legs belcantiste d’une Leyla Gencer, par exemple, serait inexistant !
Bien évidemment, l’addiction au rituel de la représentation en soi, de cet instant où le public va partager quelque chose de l’ordre du festif (depuis l’accord initial de l’orchestre jusqu’aux applaudissements aux rideaux), vient couronner cette émouvante évocation où tout, absolument tout, était fait – pour peu qu’on se laisse prendre par la main – pour faire savamment monter crescendo la tension du spectateur passionné. De même, l’évocation de lieux de partage culturel tels que le poulailler (pour Marseille…), où le public faisait la queue sans pré-réservation, et parfois plusieurs heures selon la qualité des distributions réunies, permet d’insister sur leur importance non négligeable alors – mais malheureusement trop oubliée aujourd’hui – dans l’apprentissage des fondamentaux du genre et de se souvenir de cette sorte de bouillonnement qui évoquait irrésistiblement l’ambiance des virages du stade Vélodrome [3] !
Même si Jean-Philippe Thiellay ne se livre pas ici à un travail psychologique – voire psychiatrique ! – sur les passionnés d’opéra, qui n’est pas son sujet [4], il parvient à dégager quelques lignes de crête permettant de mieux saisir ce que les publics, si divers dans la galaxie opératique, viennent rechercher dans une maison d’opéra. Entre goût de la musique, de la mélodie, des voix, du théâtre, de la sortie culturelle parmi d’autres, voire d’un marqueur social permettant de voir et d’être vu, chaque individu fait ses choix et trouve dans l’opéra comme un miroir lui renvoyant sa capacité à éprouver, à être touché, à ressentir des émotions éminemment humaines , à retrouver aussi quelque part la réminiscence d’une sensation déjà éprouvée et dont la quête est à la fois source de plaisir et de frustration… un double sentiment bien connu des passionnés d’art lyrique et qui, parfois, à force de comparaisons et de plus grande difficulté à être totalement satisfait, peut trop faire oublier le bonheur de l’écoute immédiate !
À juste titre, l’auteur s’empresse de préciser qu’il n’est pas de ceux-là : même après avoir arpenté l’arrière-cuisine de la « grande boutique » qu’il a administrée sous l’ère Lissner et avoir côtoyé de près les artistes, il a su garder la passion des premiers temps et c’est ce qui le rend totalement légitime à parler au long des cinq actes qui suivent, preuves et témoignages à l’appui, de ses graves inquiétudes. En effet, même si l’Opéra, au cours des derniers siècles, a constamment dû livrer bataille pour réformer son esthétique et pour se maintenir en vie, les mutations des pratiques culturelles, si rapides désormais, exhortent à explorer, diagnostiquer et combattre le mal si on veut sauver l’art lyrique.
Des modèles économiques à bout de souffle
À l’Acte I, il convient tout d’abord d’insister sur ce que l’auteur considère comme « un miracle depuis 400 ans » : le fait que l’opéra aura su se renouveler au point de devenir, au XIXe siècle, une pratique culturelle populaire et la 1ère industrie culturelle mondiale où, sans marché commun, l’Europe opératique d’alors dispose pour se vendre d’atouts exceptionnels, au 1er rang desquels figurent des compositeurs et des artistes géniaux ! De même, il est opportun de rappeler que, dans les quarante dernières années, l’offre en matière lyrique s’est progressivement élargie (depuis le baroque jusqu’aux compositeurs du début du XXe siècle, en passant bien évidemment par Rossini !) et que l’opéra s’est même invité dans les foyers, à travers la publicité , la pop., le cinéma…. Avec ses quelques 900 spectacles lyriques par an et ses 1 200 000 billets vendus (dont les 2/3 certes pour l’Opéra National de Paris), la France est en tête des pays d’Europe qui subventionnent largement leurs théâtres lyriques (près de 400 millions d’euros) même si c’est toujours bien peu par rapport aux quelques 9 millions de billets vendus annuellement pour assister à un match de foot et encore moins si on compare le lyrique aux quelque 25 millions de billets vendus pour des concerts pop …
Pas de quoi s’alarmer alors ? D’autant plus qu’avec certains phénomènes d’ampleur planétaire tels que, par exemple, la série de concerts des trois ténors, l’opéra demeure tout de même encore, au XXe siècle, une affaire lucrative pour les industries de l’audiovisuel et pour les architectes puisque l’auteur nous fait découvrir que la construction de théâtres (plus « performing art centers » que lieux dédiés au seul art lyrique cependant) et l’envie d’opéra ne cessent d’augmenter sur tous les continents, jusqu’à observer des phénomènes d’acculturation où des compositeurs asiatiques ou originaires du Moyen-Orient répondent à des commandes de théâtres européens ou nord-américains.

Et pourtant, à l’acte II, Jean-Philippe Thiellay nous donne quelques tendances chiffrées de ce qu’il faut bien appeler « des modèles économiques à bout de souffle ». Le diagnostic, celui de la maladie des coûts croissants, posé dès le milieu des années 60 par les professeurs d’économie William J. Baumol et William G. Bowen [5], est sans appel : la tendance de la croissance des prix à demeurer inférieure à celle des coûts signifie que les organisations culturelles ont dû demander de plus en plus d’argent à des partenaires… dont l’apport a des limites !
Longtemps, pourtant, les gouvernants d’Europe se sont comportés en mécène et l’appel aux fonds publics ou privés était une constante bien huilée pour combler l’inflation des coûts de production. Aujourd’hui, l’accroissement exorbitant de la masse salariale – qui représente jusqu’à 85% des dépenses de fonctionnement pour les maisons d’opéras disposant d’effectifs permanents pour l’orchestre, le chœur voire le ballet – s’ajoutant à des dépenses de production et de technologies le plus souvent à la hausse (avec l’utilisation de la vidéo et du mapping…) rendent indispensables la recherche d’autres sources – parfois bien lointaines ! – de financement. Or parallèlement, les prix de la billetterie augmentent (passant, pour l’Opéra de Paris, de 30 à près de 80 millions d’euros !) et la montée en puissance du recours au mécénat – à des niveaux variables selon les scènes – est de plus en plus fléchée, ce qui limite la faculté des opéras à financer, grâce aux dons, le tout-venant et les salaires du théâtre. À l’Opéra de Paris, l’auteur nous apprend que la progression du mécénat a été stoppée net et ne pourra plus atteindre des montants pouvant aller jusqu’à 80 millions d’euros, ce que va pourtant un jour requérir la progression des coûts et la stagnation de la subvention….
La fin de l’acte II délivre donc un climat d’inquiétude où, au niveau international comme au sein de l’hexagone, le confort du dirigeant de théâtre lyrique des années 80, attendant que la subvention tombe pour s’interroger sur l’innovation et sur la meilleure réponse à donner aux attentes du public, comme l’impossibilité, désormais, de boucler des budgets où les dépenses augmentent et où les recettes stagnent, ne permettent pas d’assurer la création et la qualité du spectacle vivant.
Les risques mortifères de la cancel culture
Le troisième acte de l’enquête ne fait qu’aggraver le diagnostic puisqu’il est centré sur « le choc culturel de la génération Z ». Dans un contexte de finances locales dégradées, on peut comprendre, avec l’auteur, que le décalage entre le poids des opéras dans les budgets communaux consacrés à la culture (50% à Bordeaux par exemple) et la part de la population qui franchit la porte des théâtres lyriques interroge les élus. Les réactions de certains décideurs territoriaux fraîchement arrivés aux commandes et pointant la faiblesse, réelle ou préjugée, des actions socioculturelles des opéras en faveur des banlieues et de la diversité, n’ont d’ailleurs pas tardé à se faire sentir : ainsi de l’Opéra National de Lyon qui, en 2021, décide que « les décors coûtent cher, pour quelques rares représentations » et réduit de 500 000 euros sa subvention !
On le sait, l’argument selon lequel les impôts locaux ne doivent pas financer principalement un loisir patrimonial destiné aux plus anciens et aux plus riches, auquel des pans entiers de la population n’ont pas accès, risque de continuer à faire florès : année après année, le jeune public, en particulier, est en recul et représente moins de 6% de tous les spectateurs des opéras de France. Citant Michel Guérin dans Le Monde, Jean-Philippe Thiellay expose en quoi, dans une époque où les formes d’attention ont bien changé et où la culture de salon remplace peu à peu la culture de sortie, l’enjeu de demain sera de donner envie à la génération Z d’aller au théâtre, au musée, au ciné (autrement que pour s’y divertir…) ou même de lire un livre… Au même acte, n’hésitant pas à parler d’ubérisation de la consommation culturelle, l’auteur pointe également les risques mortifères de la cancel culture et du politiquement correct où l’art lyrique est de plus en plus vu par de nombreux spectateurs d’aujourd’hui comme l’écho de la domination de l’homme blanc et « civilisé » sur des non-européens différents, étrangers et subordonnés… Dans des pages très fortes, l’auteur dénonce le risque d’une telle dérive qui nécessairement en appelle une autre et pourrait bien placer les directeurs de maisons d’opéras entre, d’une part, la conviction erronée qu’il n’y aurait aucune difficulté quant à la diversité à l’opéra et, d’autre part, le choix de faire disparaître une partie du patrimoine culturel et de limiter la création artistique par des considérations sociales ou politiques. Connaissant le cursus de l’auteur, on ne s’étonnera pas ici que le livre plaide pour des directeurs d’opéra qui puissent exercer leur charge avec la plus grande liberté de programmation, écartant ce qu’ils jugent nécessaire, proposant une démarche artistique permettant le débat, l’analyse, l’éducation… : une situation idéale dont on semble souvent bien loin … !
Le « pari à faire sur l’art lyrique »
Pourtant, il n’est pas qu’utopique de penser, comme le souligne à raison Jean-Philippe Thiellay, que dans une municipalité, la présence d’une maison lyrique est certes un poste de dépense important dans le budget culturel mais aussi un outil de rayonnement et d’attractivité générant un retour sur investissement non négligeable. Il faut donc le rappeler : la puissance publique en France peut trouver intérêt à subventionner des opéras, employeurs de dizaines de milliers de personnes et contribuant à l’attractivité des métropoles !
Ce véritable pari à faire sur l’art lyrique – l’auteur le constate au fil des pages – n’est pas celui que les édiles locaux sont prêts à tenir et l’heure est malheureusement plus que jamais au rétrécissement des saisons en province, si l’on en juge par le nombre de levers de rideau qui, entre 2005 et 2015, baisse d’environ 25% !
Les institutions lyriques sont également confrontées à des défis esthétiques cruciaux : c’est l’objet de l’acte IV de l’ouvrage. En effet, la concentration des représentations sur un petit nombre de titres et de compositeurs (toujours les mêmes…!) fait de plus en plus poindre, pour l’auteur, un risque de standardisation croissante de l’opéra et de banalisation de la création lyrique. N’hésitant pas à dénoncer les déviances commerciales de représentations ayant pour cadre des arenas et des stades au son amplifié, tout comme une certaine vulgarisation de l’art lyrique dans des lieux tels que les arènes de Vérone ou le festival de Bregenz où la qualité artistique n’est plus toujours au rendez-vous, Jean-Philippe Thiellay pose dans ce chapitre une question particulièrement fondamentale pour les directeurs d’opéras : « Pourquoi la démocratisation ou tout au moins l’ouverture à des dizaines de milliers de fans dans un stade reposent-elle souvent sur la médiocrité, c’est-à-dire sur la vulgarisation de mauvaise qualité, à grands coups de marketing et aux techniques de la culture de masse qui ne sont pas adaptées à l’opéra et l’abîment, même ? Quelles barrières psychologiques faut-il abattre pour que cette ouverture soit celle des théâtres à l’italienne ? »

Sans doute, a minima, faut-il que les théâtres se donnent une obligation de moyens mais, plus encore, une obligation de résultat, s’ils veulent sauver l’essentiel que l’auteur place, dans ce chapitre, sous le signe du maintien coûte que coûte du lien avec le public. Tout en exposant les grands défis qui sont ceux de la création lyrique aujourd’hui (comment présenter une œuvre du XXe siècle sans la trahir ? De quelle marge de liberté peut user l’équipe scénographique sans dénaturer l’œuvre ni perdre le public ?), l’auteur rappelle salutairement la décision de la Cour de cassation du 22/06/2017 qui, dans l’environnement explosif de la production Tcherniakov de Dialogues des carmélites, prône un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l’auteur du livret. On peut se réjouir ici de lire que les metteurs en scène n’ont pas pris le pouvoir et que celui-ci appartient toujours au directeur de l’institution : « La prise de pouvoir par les metteurs en scène est l’alibi des directions faibles. » martèle Jean-Philippe Thiellay. On aimerait, parfois, en être davantage persuadé…
Une chose demeure certaine dans cette partie du plaidoyer : la mission des directeurs de théâtre est tout sauf un long fleuve tranquille et l’équation à résoudre relève du casse-tête permanent ! Comment, en effet, face à un répertoire figé qui peine à se renouveler, maintenir une dimension de « grand spectacle » à certaines des « œuvres-fossiles » du genre – ce qui, pour un temps du moins, s’avèrera gagnant pour les néophytes et les plus jeunes spectateurs – tout en évitant le risque de ringardisme « alla Zeffirelli » et l’intellectualisme incompréhensible ? Ne plus tolérer la médiocrité ni le travail bâclé dans les productions confiées constitue pour l’auteur un bon début de consensus.
« Il faut le sauver, il est temps ! »
C’est cependant au dernier acte, empruntant son titre à une phrase extraite de l’Esclarmonde de Massenet, « Il faut le sauver, il est temps », que Jean-Philippe Thiellay, revenant sur les pistes déjà ouvertes aux actes précédents, se veut porteur de solutions possibles.
Au-delà des concours publics toujours indispensables, trois axes de progrès pourraient se dégager :
- Tout d’abord, un axe centré sur un management participatif : dans des institutions où le « chantage au lever de rideau » et la grève sont souvent chroniques, il est indispensable d’associer les salariés au projet artistique, en gardant à l’esprit que la direction d’un opéra n’est pas un métier comme un autre ! De même, pour conjurer au mieux la malédiction des coûts croissants, les mots-clefs devraient être l’inventivité, notamment dans la programmation artistique, et la mutualisation, en favorisant de nouvelles productions qui puissent être amorties sur quelques séries de reprises, des types divers de co-productions [6] ou, de façon plus ambitieuse car touchant au politique, des regroupements de théâtre.
- Ensuite, un axe centré sur la recherche de recettes venant parallèlement enrichir l’expérience du spectateur : ici, Jean-Philippe Thiellay tourne ses regards vers le monde du sport et du divertissement, considérant qu’il est devenu indispensable de multiplier les espaces collectifs de rencontre dans le théâtre, avant et après le spectacle, pour retrouver au sein du public un esprit collectif. De l’utilisation du digital à la valorisation des lieux magiques que peuvent être les Opéras en passant par une ouverture accrue sur les droits culturels, tout, absolument tout, doit être tenté pour désinhiber la relation à l’art lyrique.

- Enfin, et cela est lié à ce qui précède, un axe centré sur les nouvelles formes de relations à créer avec le spectateur. Outre les innombrables initiatives en matière de programme liant Éducation Nationale et Opéras, les théâtres doivent, surtout, sortir de leurs murs et aller à la rencontre du public, sans aucune concession sur la qualité. La question de l’enseignement à devenir spectateur est également posée ici par l’auteur. Dans un pays où la question de l’éducation musicale fait problème, Jean-Philippe Thiellay pose le principe que tout collégien, après y avoir été préparé, doit avoir assisté à au moins un spectacle lyrique dans sa scolarité.
Mais c’est avant tout sur une nouvelle génération de directeurs d’opéra – parmi lesquels Jean-Philippe Thiellay serait sans doute légitime …- qu’il faudrait parier pour réinventer l’Opéra. Ce sont à eux que l’auteur s’adresse, pour prendre congé de son lecteur, lorsque, paraphrasant Marc Twain, il écrit : « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »
———————————————-
[1] On se souvient que Jean-Philippe Thiellay a publié en 2018 chez Actes Sud une biographie de Meyerbeer.
[2] Comme les comptes-rendus de Première Loge ont régulièrement l’occasion de s’en faire l’écho…
[3] …comme peut aussi en attester le rédacteur de cet article !
[4] et qui a, de toute façon, été traité, en particulier par Wayne Koestenbaum dans Anatomie de la « folle lyrique », à juste titre cité dans la bibliographie.
[5] William J. Baumol et William G. Bowen Performing Arts : The Economic Dilemma (1966)
[6] L’exemple de ARSUD, régie régionale de la région PACA devenue co-productrice de La Dame de pique qui, après Nice et Marseille, continue sa tournée avec Toulon et Avignon, est en cela encourageant…