Zurich : Eliogabalo de Cavalli, ou l’anarchie au pouvoir

Eliogabalo de Cavalli à Zurich : quand l’opéra baroque met en scène le sulfureux Marc Aurèle Antonin Auguste, devenu empereur de Rome à quatorze ans.
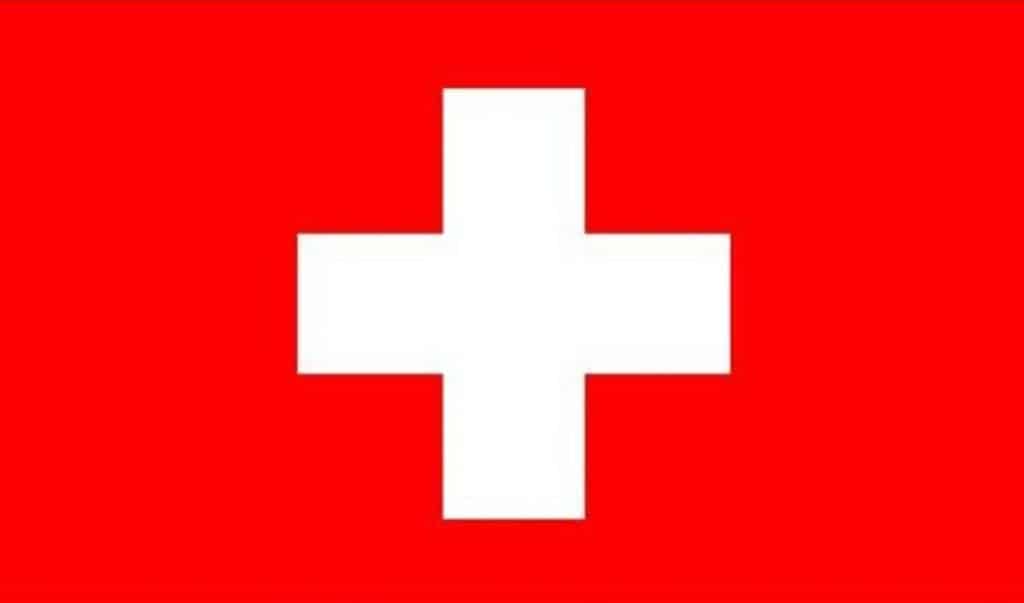
Après le Palais Garnier en 2016, l’Opéra de Zurich propose l’Eliogabalo de Cavalli dans une excellente production, très applaudie par le public.
Un empereur excentrique mais moins sulfureux que ne le dit sa légende…
Un garçon de quatorze ans se retrouve empereur de Rome, « voire du monde » comme le dit Lenia, et savoure la volupté du pouvoir. C’est ce que narre le livret (signé d’un auteur inconnu) de l’Eliogabalo mis en musique par Francesco Cavalli pour la saison du carnaval vénitien de 1668.
Marc Aurèle Antonin Auguste, né sous le nom de Sestus Varius Avitus Bassianus, est le premier empereur romain d’origine asiatique : descendant de la dynastie des Sévères, grand prêtre du dieu soleil (El-Gabal en syriaque, et donc appelé Héliogabale ou Elagabale), il est reconnu empereur et accède au pouvoir à l’âge de quatorze ans seulement, en 218 après J.-C., en opposition à l’empereur Macrinus. Pendant les quatre années de son règne, il tente d’imposer le culte du soleil, mais cette politique religieuse, ainsi que les excès et les excentricités de sa cour, suscitent une opposition croissante à son égard, qui culmine avec son assassinat par un garde prétorien et la prise du pouvoir par son cousin Alexandre Sévère.
Victime de la damnatio memoriæ, sa réputation douteuse a été hostilement et exagérément noircie par les premiers historiens chrétiens. L’historiographie moderne a en partie réhabilité sa figure, en restituant de l’empereur un portrait nuancé, qui prend corps dans un fort contraste entre le conservatisme romain et le dynamisme du jeune Syrien. Mais en 1667, année de composition de l’ouvrage de Cavalli, l’image de l’empereur reposait sur l’Historia Augusta, dans laquelle ragots et inventions étaient légion. Ainsi, le texte de l’opéra n’hésite pas à insister sur la débauche du protagoniste, le décrivant comme « langoureux, lascif, efféminé, lubrique ». Ici, le jeune empereur semble peu intéressé par la politique : il préfère s’adonner à des accouplements hétéroclites en genre et en quantité, va jusqu’à créer un sénat exclusivement féminin afin d’approcher plus facilement sa bien-aimée, et se déguise en femme. Mais ce n’est pas de sa faute : c’est ce que veut son destin, inscrit dans les étoiles, comme il le dit à Eritea, la première de la longue série de femmes à qui il promet le mariage. Héliogabale lui-même, dans un délire de toute-puissance, exalte et justifie sa malfaisance : « La foi que je n’observe pas acquiert un nom et un éclat : ce qui donne à la loi son éclat, c’est le fait même que je l’enfreigne », dit-il avant de se tourner vers la vieille Lenia en lui demandant de « lui trouver un autre objet de plaisir ». Don Juan ante litteram, il aimerait « pouvoir posséder toutes les femmes et jouir de mille beautés en un seul et même lieu ».
Retour en grâce du dernier opéra de Cavalli
Dernier des vingt-sept opéras que nous a laissés l’organiste et maître de chapelle ducal de Saint-Marc, l’Eliogabalo ne fut jamais mis en scène comme prévu pour le carnaval de 1668 et fut remplacé par le dramma per musica homonyme de Giovanni Antonio Boretti sur le même texte remanié par Aurelio Aureli. Les raisons de cette substitution nous sont inconnues. Après 300 ans de silence, l’œuvre a été présentée lors de l’inauguration du nouveau théâtre San Domenico à Crema, ville natale du compositeur. Puis en 2004, il y a eu l’édition critique de Mauro Calcagno à la Monnaie de Bruxelles, basée sur le manuscrit conservé à la Biblioteca Marciana de Venise. Cette production a été suivie de nouvelles productions au Festival d’Aspen (août 2007), à Northington (juillet 2009), à Dortmund (octobre 2011), à New York (Gotham Chamber Opera, mars 2013) et à Paris (Palais Garnier, octobre 2016).
Cette nouvelle production zurichoise est confiée à Calixto Bieito, qui avait mis en scène ici l’an dernier L’incoronazione di Poppea de Monteverdi, une autre histoire d’empereurs romains dissolus. Le metteur en scène espagnol devait avoir en tête Héliogabale ou l’Anarchiste couronné, l’essai de 1934 dans lequel Antonin Artaud avait abordé la vie de l’empereur romain en déclarant que : « Toute la vie d’Héliogabale est une anarchie en action […] feu, geste, sang, cri […] Fanatique, un vrai roi, un rebelle, un individualiste fou ». Dans la lecture de Bieito et dans la dramaturgie de Beate Breidenbach, l’histoire de cet autocrate égocentrique investit le thème très actuel du genre, avec un protagoniste qui fait preuve d’un polymorphisme désinhibé à l’égard de sa sexualité et d’une recherche paranoïaque du plaisir. Dans sa folie, il en arrive à l’auto-émasculation pour atteindre l’équivalence totale des sexes. Oscillant entre hédonisme et cruauté, le personnage d’Héliogabale démontre tout son malaise et toute son instabilité en tant que personne.
Ne pouvant prendre appui sur la narration, ici totalement dépourvue de logique et tout sauf linéaire, le metteur en scène s’attache à créer des images à fort impact émotionnel grâce au décor en noir et blanc conçu avec Anna-Sofia Kirsch, aux costumes contemporains d’Ingo Krüger et surtout au jeu de lumière évocateur de Franck Evin. Les vidéos d’Adria Bieito Camì ne sont pas toujours nécessaires, mais elles complètent l’aspect visuel d’un spectacle très riche où l’on voit apparaître la salle du Sénat romain, une grande boîte noire qui descend lentement d’en haut avec Héliogabale enlaçant un taureau (un élément fréquent dans les productions de l’Espagnol Bieito), une cage qui s’élève d’en bas pour enfermer le « monstre », une moto, un canapé blanc sur lequel a d’abord lieu la tentative de viol de Flavia Gemmira, puis où, par la suite, le couple Zoticus et Heliogabalus, lui émasculé et en robe de mariée blanche, regarde des films romantiques en noir et blanc.
Belle réussite musicale
Musicien complet, Dmitry Sinkovsky se produit non seulement en tant que violon solo, mais aussi en tant que violoniste et chanteur : au début, il prend son instrument pour interpréter le thème de la sinfonia, et lorsque la deuxième des deux parties du spectacle reprend, il se tourne vers le public et chante de façon inattendue l’air « Dammi morte o libertà » de l’Artemisia de Cavalli avec sa belle voix de contre-ténor, qu’il interprète avec une grande intensité. Dans le cas d’une telle partition, le travail du chef d’orchestre est tout sauf limité à la concertation des instrumentistes et des chanteurs : il s’agit ici de reconstruire une partition à peine esquissée – on ne dispose que de la basse continue et des lignes de chant – et le chef d’orchestre doit donc s’engager également sur le plan de la composition. Le résultat se révèle excellent : le recitar cantando de Cavalli, qui se fige dans les moments les plus intenses en lignes mélodiques d’une extrême sensualité et mélancolie, est ici présenté avec le son plein, riche et somptueux de La Scintilla, l’ensemble spécialisé dans la musique ancienne sur instruments historiques, qui compte ici dix violons, trois violoncelles, deux violes de gambe, deux contrebasses, deux flûtes baroques, quatre cornets, une dulzaina, deux trombones, trois percussionnistes, une harpe, un clavecin, un théorbe, une guitare et un chitarrone.
L’ambiguïté propre aux personnages de l’histoire se retrouve dans la distribution, dans laquelle une vieille femme (Lenia) est jouée par un homme (le ténor Mark Milhofer, toujours attentif à ne pas exagérer le déguisement grotesque) ; un garçon amoureux (Giuliano Gordio) par une femme (la très acclamée Beth Taylor, soprano) ; deux contre-ténors de renom assurent le rôle-titre (Yuriy Mynenko) et celui d’Alexandre César (David Hansen), et expriment toute la diversité que peut offrir ce registre vocal : chez l’Ukrainien, on admire l’assurance et la projection vocale, chez l’Australien l’expressivité et les demi-voix persuasives. Les femmes victimes de la sensualité furieuse du despote trouvent en Siobhan Stagg (Anicia Eritea), Anna El-Khashem (Flavia Gemmira) et Sophie Junker (Atilia Macrina) de fines interprètes. Le ténor anglais Joel Williams affiche une présence vocale et physique assurée dans le rôle de Zotico, tandis que la basse Daniel Giulianini se montre trop généreuse avec son médium vocal, son Nerbulone en devenant parfois excessif. Giulianini est le seul Italien dans une distribution qui, par ailleurs, ne brille pas par la clarté de sa diction… Mais pour un public non italien, ce n’est peut-être pas un problème majeur et l’excellence de la mise en scène, des chanteurs et de l’orchestre ont amené les spectateurs zurichois à saluer le spectacle et les artistes par des applaudissements chaleureux et prolongés. Nous avons assisté à la dernière représentation, et nous ignorons si cette production pourra être revue ailleurs, ni si elle a été enregistrée…
https://youtu.be/6y3VHrjoZfU
Pour lire cet article dans sa version originale (italien), cliquez sur le drapeau !
Eliogabalo : Yuriy Mynenko
Anicia Eritea : Siobhan Stagg
Giuliano Gordio : Beth Taylor
Flavia Gemmira : Anna El-Khashem
Alessandro Cesare : David Hansen
Atilia Macrina : Sophie Junker
Zotico : Joel Williams
Lenia : Mark Milhofer
Nerbulone : Daniel Giulianini
Tiferne : Benjamin Molonfalean
Un console : Aksel Daveyan
Altro console : Saveliy Andreev
Orchestra La Scintilla, Statistenverein am Opernhaus Zürich, dir. Dmitry Sinkovsky
Mise en scène : Calixto Bieito
Décors : Anna-Sofia Kirsch, Calixto Bieito
Costumes : Ingo Krügler
Lumières : Franck Evin
Vidéo : Adria Bieito Camì
Dramaturgie : Beate Breidenbach
Eliogabalo
Dramma per musica en trois actes de Francesco Cavalli (1602-1676), livret anonyme, remanié par Aurelio Aureli, créé à Crema en 1999.
Représentation du samedi 7 janvier 2023, Opéra de Zurich
